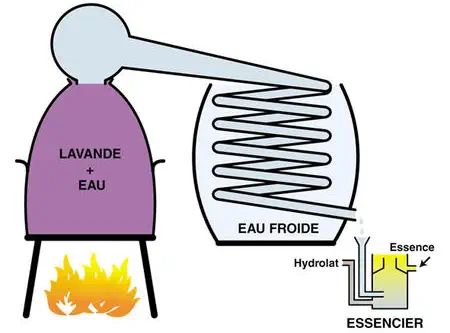Le mot alambic vient de l'arabe al 'inbïq, lui-même emprunté au grec tardif ambix (= vase).
L'invention de l'alambic est attribuée aux arabes, aux alentours du Xe siècle.
Ainsi
Abu
Al-Qasim
(Aboulcassis),
un
des
plus
grands
chirurgiens
arabes,
passe
pour
en
être
l'inventeur.
Mais le principe existait déjà bien avant, et les grecs le connaissaient.
On
trouve
des
traces
de
l'invention
de
l'alambic
par
les
Égyptiens
et
en
Mésopotamie
vers
3500
ans
avant JC.
Après
les
Mésopotamiens,
ce
sont
les
Égyptiens
de
l’Antiquité
qui
ont
développé
la
technique
de
la
distillation adoptée ensuite par les Grecs.
Le
principe
de
distillation
est
décrit
dans
les
traités
de
deux
femmes
chimistes
Égyptiennes,
appelées
Cléopâtre
et
Marie,
et
dont
fait
état
le
traité
du
IIIème
siècle
de
Zozime
conservé
dans
la
Bibliothèque de Saint-Marc à Venise.
Au Moyen-âge, l’alambic est assez largement utilisé dans le pourtour méditerranéen.
C’était
probablement
une
machine
très
rustique
qui
a
été
améliorée
à
partir
du
XIIIème
siècle,
en
Italie d’abord, puis dans le sud de la France au XVIIème siècle.
Mais
c’est
fin
XVIIIème,
et
surtout
début
XIXème,
que
les
principales
améliorations
sont
apportées
par
Edouard
Adam
à
Montpellier
grâce
aux
travaux
du
chimiste
de
Nîmes,
Laurent
Solimani,
ensuite par Isaac Bérard, fabricant d’eau-de-vie à Gallargues près de Nîmes.
Ces
développements
aboutissent
au
dépôt
de
plusieurs
brevets
dont
celui
de
1811
au
nom
de
tous
les
"inventeurs", Adam, Solimani et Bérard.
L'alambic
fut
d'abord
utilisé
pour
fabriquer
des
eaux
florales,
des
huiles
essentielles
ou
des
médicaments,
avant
de
permettre
la
production
d'eau
de
vie
par
distillation
de
jus
de
fruits
fermentés.
Un
alambic
simple
comprend
un
premier
récipient
comprenant
le
moût
(liquide
à
distiller)
lequel
est chauffé (bain-marie, gaz, feu de bois...).
Les vapeurs d'alcools qui se forment sont dirigées dans un tuyau, avec lequel elles seront refroidies.
Condensées
et
refroidies,
ces
vapeurs
se
transformeront
en
liquide
et
seront
récupérées
dans
un
récipient.