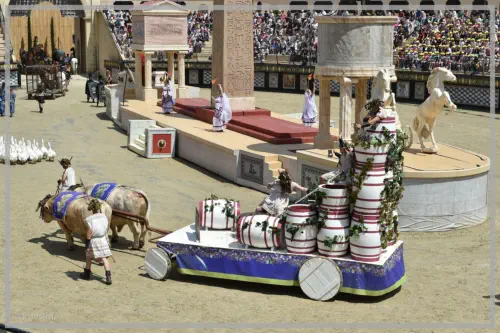Venant
de
la
mythologie
grecque,
Dionysos
(fils
de
Zeus
et
de
Sémélése),
il
se
retrouve
sous le nom de Bacchus chez les romains.
Dieu
de
la
vigne,
de
la
végétation
et
des
plaisirs,
chez
les
romains,
il
était
le
fils
de
Jupiter
et d'une simple mortelle, la princesse Sémélé.
Junon, l'épouse légitime, la fit périr dans l'incendie de son palais.
Heureusement,
Jupiter
réussit
(par
on
ne
sait
quelle
opération
...
)
à
sauver
le
fœtus
et
à
le
mettre
dans
sa
cuisse
où
il
le
garda
le
temps
nécessaire
pour
qu'il
termine
son
développement (d'où l'expression bien connue: "être né de la cuisse de Jupiter").
Il
voyagea
beaucoup
pour
échapper
au
courroux
tenace
de
Junon,
accompagné
par
son
père nourricier Silène.
Ce
dernier
l'initia
aux
plaisirs
du
vin
qui,
selon
lui,
éclaircissait
l'esprit
et
permettait
de
pénétrer
les
mystères
de
la
création
du
monde
(beaucoup
ont
courageusement
essayé
depuis
...
et
on
ne
sait
toujours
rien
...
il
faut
dire
qu'ils
oublient
régulièrement
la
couronne
de lierre qui dissipe les effets de l'ivresse ...).
On
dit
que
les
masques
et
les
cris
des
cortèges
de
Bacchus
donnèrent
naissance
aux
premières
représentations
théâtrales
qui
d'ailleurs
commençaient
toujours
par
un
sacrifice au dieu ...
souvent des pies ...
car elles sont bavardes, comme ceux qui ont trop bu ... !



Bacchus : Le dieu romain du vin et de la fête
Bacchus,
figure
emblématique
de
la
mythologie
romaine,
incarne
l'esprit
de
la
célébration,
du vin et de la libération.
Divinité
majeure
du
panthéon
romain,
il
représente
à
la
fois
la
joie
et
les
excès,
la
nature
sauvage et la civilisation.
De
sa
naissance
extraordinaire
à
l'héritage
qu'il
a
laissé
dans
l'art
et
les
traditions,
découvrez
comment
ce
dieu
complexe
a
façonné
notre
compréhension
de
la
dualité
entre
ordre et chaos, entre raison et passion.
Origines et identité mythologique
Naissance divine et tribulations
La
naissance
de
Bacchus
constitue
l'un
des
récits
les
plus
extraordinaires
de
la
mythologie
romaine.
Fils
de
Jupiter
(Zeus
dans
la
mythologie
grecque)
et
de
Sémélé,
une
princesse
mortelle
de
Thèbes, sa venue au monde est marquée par le drame.
Manipulée
par
la
jalouse
Junon
(Héra),
Sémélé
demande
à
voir
Jupiter
dans
toute
sa
splendeur divine.
Lié
par
une
promesse
irrévocable,
Jupiter
se
présente
à
elle
dans
sa
forme
véritable,
mais
aucun
mortel
ne
peut
supporter
la
vision
d'un
dieu
sans
protection
:
Sémélé
est
instantanément consumée par les flammes divines.
Dans
un
acte
désespéré
pour
sauver
son
fils,
Jupiter
extrait
le
fœtus
du
ventre
de
Sémélé
et,
dans
un
geste
sans
précédent,
le
coud
dans
sa
propre
cuisse
où
l'enfant
poursuivra
sa
gestation jusqu'à terme.
Cette
seconde
naissance,
directement
issue
du
corps
d'un
dieu,
confère
à
Bacchus
un
statut
particulier
:
né
deux
fois
(dithyrambos
en
grec),
il
incarne
déjà
la
dualité
et
la
renaissance qui caractériseront son culte.
Une enfance menacée
La jalousie de Junon ne s'éteint pas avec la mort de Sémélé.
Pour
protéger
l'enfant
divin,
Jupiter
le
confie
aux
nymphes
du
mont
Nysa,
lieu
mythique
dont la localisation reste volontairement imprécise.
Ces
années
de
formation
marquent
profondément
Bacchus,
qui
conservera
toujours
un
lien privilégié avec les créatures de la nature et les espaces sauvages.
C'est
durant
cette
période
qu'il
découvre
la
vigne
et
ses
propriétés,
développant
l'art
de
la
vinification qu'il partagera ensuite avec les humains.
Certaines
versions
du
mythe
évoquent
également
un
épisode
dramatique
où
Junon,
toujours
déterminée
à
éliminer
ce
fils
illégitime,
aurait
envoyé
les
Titans
pour
le
déchiqueter.
Après
avoir
réussi
leur
funeste
mission,
le
cœur
de
l'enfant
aurait
été
sauvé
puis
ingéré
par
Jupiter,
permettant
une
troisième
naissance
miraculeuse
de
Bacchus,
renforçant
encore
son association avec les cycles de mort et de renaissance.
Liber Pater : l'assimilation latine
Dans
la
religion
romaine
originelle,
avant
l'importation
massive
des
cultes
grecs,
existait
déjà
une
divinité
nommée
Liber
Pater
("Père
Libre"),
associée
à
la
fertilité
agricole,
la
fécondité et la liberté.
Cette
divinité
italique
fut
progressivement
assimilée
à
Bacchus/Dionysos
lorsque
son
culte
fut introduit à Rome.
Cette fusion sémantique est particulièrement significative.
Elle
souligne
la
dimension
libératrice
de
Bacchus,
qui,
à
travers
le
vin
et
l'extase
mystique,
permet
aux
humains
de
s'affranchir
temporairement
des
contraintes
sociales
et
des
limitations de la conscience ordinaire.
Cette
double
identité,
Bacchus
et
Liber
Pater,
témoigne
de
la
complexité
de
cette
figure
divine qui transcende les catégories simples.
Ni
tout
à
fait
grec,
ni
pleinement
romain,
Bacchus
incarne
une
force
religieuse
transculturelle
qui
a
su
s'adapter
et
évoluer
à
travers
différentes
civilisations
méditerranéennes.
Attributs, symboles et représentations
L'iconographie
de
Bacchus
s'est
développée
sur
plusieurs
siècles,
évoluant
des
représentations
archaïques
aux
interprétations
sophistiquées
de
l'époque
romaine
impériale.
À
travers
ces
évolutions,
certains
attributs
et
symboles
sont
demeurés
constants,
permettant
d'identifier
immédiatement
cette
divinité
complexe
dans
l'art
antique
et
moderne.
Le thyrse
Le
bâton
cérémoniel
de
Bacchus,
appelé
thyrse,
constitue
l'emblème
de
son
autorité
divine.
Cette
longue
tige,
habituellement
faite
de
fenouil,
est
surmontée
d'une
pomme
de
pin
et
enveloppée de feuilles de lierre et de vigne.
Il
symbolise
à
la
fois
la
fertilité
(par
sa
forme
phallique)
et
le
pouvoir
transformateur
de
la
divinité.
La vigne et le vin
Le
raisin
et
la
vigne
représentent
l'attribut
primordial
de
Bacchus,
incarnant
le
cycle
de
transformation, de mort et de renaissance.
La
fermentation
du
raisin
en
vin
symbolise
le
passage
d'un
état
à
un
autre,
processus
alchimique qui reflète les mystères dionysiaques.
Le lierre
Plante
toujours
verte
qui
s'enroule
autour
des
arbres
et
des
structures,
le
lierre
symbolise
la
persistance
de
la
vie
même
en
hiver,
ainsi
que
l'adhérence
tenace
des
fidèles
à
leur
divinité.
Dans
les
rituels
"bacchiques",
les
couronnes
de
lierre
servaient
d'antidote
symbolique
aux
effets de l'ivresse.
Représentations physiques et symboliques
Contrairement
à
d'autres
divinités
masculines
du
panthéon
romain,
Bacchus
est
généralement
représenté
sous
les
traits
d'un
jeune
homme
au
visage
doux,
parfois
presque
androgyne.
Cette
apparence
efféminée,
accentuée
dans
certaines
représentations
par
des
vêtements
flottants
ou
des
postures
languides,
souligne
sa
nature
ambivalente,
transcendant
les
catégories binaires strictes.
Des
cornes
discrètes
peuvent
orner
son
front,
rappelant
son
association
avec
les
forces
vitales et les animaux sauvages.
Dans
l'art
romain,
Bacchus
apparaît
fréquemment
souriant,
le
regard
légèrement
voilé,
comme habité par l'ivresse divine qu'il incarne.
Sa
nudité
partielle
ou
complète,
courante
dans
les
sculptures,
évoque
la
liberté
qu'il
représente,
l'affranchissement
des
conventions
sociales
que
procure
l'expérience
bachique.
Souvent
couronné
de
pampres
de
vigne
ou
de
lierre,
il
tient
typiquement
une
coupe
de
vin
(canthare) dans une main et son thyrse emblématique dans l'autre.
Le cortège dionysiaque
Bacchus est rarement représenté seul.
Son
cortège,
ou
thiase,
constitue
un
élément
fondamental
de
son
identité
visuelle
et
mythologique.
Ce
groupe
de
figures
divines
et
semi-divines
qui
l'accompagnent
amplifie
et
illustre
les
différentes facettes de son pouvoir :
Les Bacchantes ou Ménades
Adoratrices
féminines
de
Bacchus,
elles
sont
représentées
dans
un
état
d'extase
mystique,
dansant
frénétiquement,
jouant
de
divers
instruments
de
musique,
ou
déchirant
des
animaux à mains nues (sparagmos) dans leur frénésie divine.
Vêtues de peaux de bêtes et couronnées de lierre, elles incarnent la libération des pulsions.
Les Satyres
Créatures
mi-hommes
mi-boucs,
les
satyres
incarnent
une
sexualité
débridée
et
une
connexion profonde avec la nature sauvage.
Figures
comiques
et
lascives,
ils
symbolisent
les
aspects
charnels
du
culte
bachique,
jouant
de la flûte et poursuivant les nymphes et les ménades.
Silène
Vieux satyre ventru et ivre, tuteur et compagnon fidèle de Bacchus.
Généralement
représenté
chevauchant
maladroitement
un
âne,
il
incarne
la
sagesse
paradoxale
que
peut
révéler
l'ivresse,
sous
ses
apparences
grotesques
se
cache
souvent
un
sage capable de profondes vérités philosophiques.
Dualité et paradoxe : l'essence de Bacchus
Au-delà
de
ses
attributs
visuels,
Bacchus
incarne
une
profonde
dualité
symbolique
qui
fait
toute la richesse de cette figure divine.
Cette
ambivalence
fondamentale
reflète
parfaitement
les
effets
du
vin
lui-même
:
source
de
joie,
de
communauté
et
d'inspiration
lorsqu'il
est
consommé
avec
mesure
;
cause
de
débordements, de violence et de folie lorsqu'il mène à l'excès.
Bacchus
préside
à
cette
frontière
délicate
entre
la
civilisation
et
la
sauvagerie,
entre
la
conscience et l'inconscient, entre la raison et l'ivresse extatique.
C'est
précisément
cette
complexité
qui
a
fait
de
lui
une
figure
si
fascinante
et
durable
dans
l'imaginaire occidental.
Le culte, les fêtes et l'héritage de Bacchus
Les Bacchanales : splendeur et scandale
Les
Bacchanales
(Bacchanalia)
constituent
l'expression
la
plus
célèbre
et
la
plus
controversée du culte bachique à Rome.
Ces
célébrations
rituelles
se
déroulaient
initialement
dans
un
cadre
relativement
restreint
:
trois
jours
par
an,
dans
un
bois
sacré
près
de
Rome,
et
étaient
exclusivement
réservées
aux femmes.
Sous
la
direction
de
prêtresses,
ces
rites
comportaient
probablement
des
danses
extatiques,
la
consommation
de
vin,
et
potentiellement
des
états
de
transe
permettant
une
communion mystique avec la divinité.
"Quand
le
vin
est
répandu,
quand
la
nuit
et
le
mélange
des
sexes,
l'âge
tendre
avec
le
plus
mûr,
ont
éteint
tout
sentiment
de
pudeur,
toutes
les
corruptions
commencent
à
se
produire..."
Tite-Live, Histoire romaine, Livre XXXIX
Vers
le
début
du
IIe
siècle
av.
J.-C.,
ces
pratiques
connurent
des
transformations
significatives.
Augmentation
de
la
fréquence
des
célébrations
(jusqu'à
cinq
fois
par
mois),
admission
des
hommes aux cérémonies et déplacement des rituels vers des espaces privés.
C'est
cette
évolution
qui
déclencha
la
répression
brutale
de
186
av.
J.-C.,
connue
sous
le
nom du "Scandale des Bacchanales" (Bacchanalia scandalum).
L'historien
Tite-Live
décrit
en
termes
alarmistes
les
activités
supposées
des
adeptes
:
débauches sexuelles, meurtres rituels, falsification de testaments, faux témoignages.
Bien
que
ces
accusations
relèvent
probablement
en
grande
partie
de
la
propagande
politique,
elles
conduisirent
le
Sénat
à
promulguer
le
Senatus
consultum
de
Bacchanalibus,
un
décret
interdisant
les
Bacchanales
dans
toute
l'Italie
et
ordonnant
l'exécution de milliers d'adeptes.
Dimension sociale
Les
Bacchanales
représentaient
une
inversion
temporaire
de
l'ordre
social
établi,
permettant
notamment
aux
femmes
d'échapper
brièvement
aux
contraintes
patriarcales
de la société romaine.
Dimension religieuse
Au-delà
des
aspects
festifs,
le
culte
comportait
une
véritable
dimension
mystique,
promettant
aux
initiés
une
relation
privilégiée
avec
la
divinité
et
potentiellement
des
formes de salut dans l'au-delà.
Dimension politique
La
répression
des
Bacchanales
s'inscrit
dans
un
contexte
de
méfiance
envers
les
cultes
étrangers perçus comme menaçant l'identité romaine traditionnelle et l'autorité de l'État.
L'héritage artistique et culturel
Malgré
la
répression
officielle,
la
figure
de
Bacchus
n'a
jamais
cessé
de
fasciner
l'imaginaire occidental.
Son
influence
s'est
manifestée
à
travers
les
siècles
dans
d'innombrables
expressions
artistiques :
Dans
l'Antiquité,
sculptures,
mosaïques
et
fresques
représentant
Bacchus
et
son
cortège
ornaient les villas romaines, les thermes et les temples.
Les
scènes
bachiques
figurent
parmi
les
motifs
décoratifs
les
plus
populaires
de
l'art
romain.
À
la
Renaissance
et
au
Baroque,
le
Caravage,
Titien,
Rubens
et
de
nombreux
autres
maîtres ont créé des œuvres monumentales célébrant Bacchus.
Ces
représentations
explorent
souvent
les
thèmes
de
l'extase,
de
l'abondance
et
de
la
sensualité.
À
l'époque
moderne,
Bacchus
inspire
encore
les
artistes
contemporains,
du
cinéma
à
la
littérature,
symbolisant
alternativement
la
liberté
créatrice,
la
résistance
aux
normes
sociales ou la recherche d'états de conscience altérés.
Bacchus aujourd'hui : persistances et transformations
L'esprit
bachique
perdure
dans
de
nombreuses
traditions
contemporaines,
même
si
la
référence explicite à la divinité antique s'est estompée.
Dans
le
monde
viticole,
Bacchus
reste
une
référence
incontournable,
donnant
son
nom
à
des cépages, des concours œnologiques et des festivités célébrant les vendanges.
Les
confréries
bachiques
perpétuent
un
esprit
de
convivialité
et
de
célébration
autour
du
vin qui trouve ses racines directes dans les traditions antiques.
Plus
largement,
l'influence
bachique
se
manifeste
dans
notre
rapport
moderne
à
la
fête,
à
l'abandon temporaire des inhibitions et à la recherche d'expériences transcendantes.
Le
carnaval,
avec
ses
inversions
sociales
et
sa
célébration
de
l'excès,
constitue
peut-être
l'héritier le plus direct des anciennes Bacchanales.
Sur
un
plan
philosophique,
l'opposition
nietzschéenne
entre
les
principes
apollinien
(ordre,
raison,
mesure)
et
dionysiaque
(chaos,
créateur,
passion,
démesure)
témoigne
de
la persistance de ces archétypes dans notre compréhension de la condition humaine.
Bacchus/Dionysos
représente
toujours
cette
part
d'ivresse,
littérale
ou
métaphorique,
nécessaire
à
l'équilibre
psychique
et
social,
ce
moment
où
les
frontières
s'effacent
et
où
l'individu se reconnecte à des forces plus vastes que lui-même.
Aujourd'hui
encore,
la
figure
de
Bacchus
nous
rappelle
cette
vérité
paradoxale
:
une
civilisation
qui
nierait
complètement
les
énergies
bachiques,
risquerait
de
sombrer
dans
une
rigidité
stérile,
tandis
qu'une
société
qui
s'y
abandonnerait
sans
mesure
courrait
à
sa
destruction.
C'est
dans
cette
tension
dynamique,
entre
ordre
et
chaos,
que
réside
peut-être
le
message
le plus profond du mythe bachique.