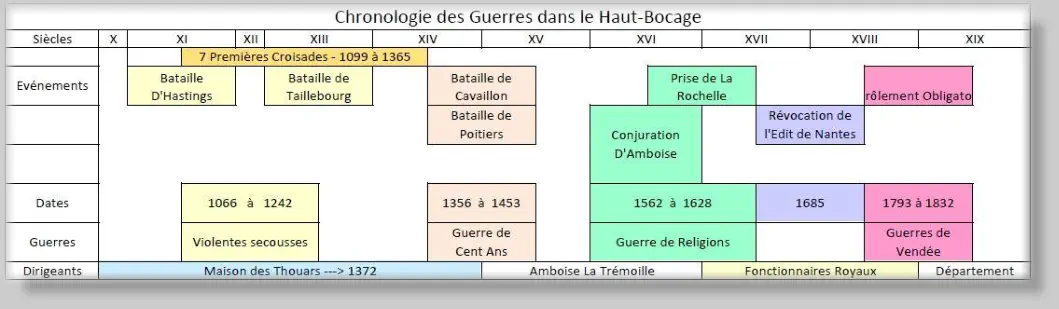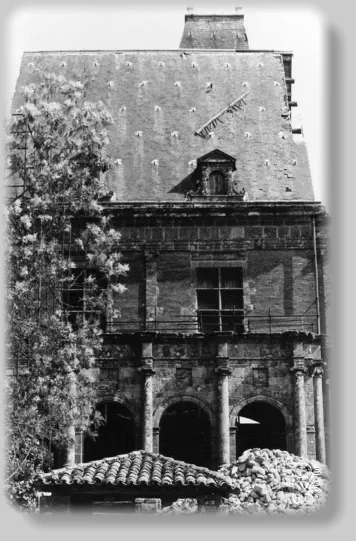Nous
sommes
à
la
veille
de
la
Grande
Révolution
Française,
de
sourds
grondements
l'annoncent,
c'est
un
monde
qui
va
basculer
et
Louis
Isaac
de
Marconnay
(1755-
1796)
ne possédera pas le Puy du Fou très longtemps.
Dés
le
début
du
soulèvement
de
Vendée,
le
château
se
trouve
au
centre
de
la
région
tenue
par
les
blancs.
Avec
la
"Virée
de
Galerne"
(16
octobre
au
23
décembre
1793),
la
situation va évoluer très vite évoluer.
Le 8 novembre 1793, le citoyen BARON rentre et investit la commune des Epesses.
Avec
ses
hommes,
il
capture
une
trentaine
d'homme
coupable
d'avoir
prit
les
armes
contre la République.
Dans
la
foulée,
il
perquisitionne
le
Puy
du
Fou
à
la
recherche
du
sénéchal
Girault
qui
a
juste
le
temps
de s'enfuir.
Le
nouveau
seigneur
était
né
le
10
mars
1755,
d'une
vieille
famille
Bas-
Poitevine,
dont
une
branche
possédera la Débutrie, en Rochetrejoux.
Il avait épousé cinq ans avant son acquisition du Puy du Fou, Louise de Badier.
Il
entra
dans
d'armée
Royale
comme
tous
les
nobles,
participa
en
1789
aux
Elections
pour
les
Etats
Généraux.
Ensuite répondant à l'appel des Princes, frères de Louis XVI (
1754-1793),
part en Emigration pour rejoindre
le Comte d'Artois, le futur Charles X
(1757-1836).
Louis de Marconnay fit la Campagne de 1792, passa en Angleterre et de là, tenta de rejoindre les Chouans
de Bretagne.
Il fut tué dans un obscur combat en 1796, et sa veuve se trouvant à Londres, recevait une lettre datée du 10
avril 1796, dans laquelle son correspondant écrivait :
"Sur cent cinquante qui sont passés ici, il y en a cent qui voudraient n'y être jamais venus".
Avant
d'émigrer
et
même
avant
d'en
avoir
terminé
avec
le
paiement
du
Puy
du
Fou,
Louis
de
Marconnay
revendit
ce
domaine,
le
17
janvier
1791,
pour
882.400
livres à Clément-Charles-François de L'Averdy (1723
1793), Contrôleur Général des Finances, protégé de Madame de Pompadour
(1721-1764).
Clément-Charles-François de L'Averdy fut victime de la Terreur.
On
l'accusa
d'avoir,
comme
Contrôleur
des
Finances,
été
l'un
des
instigateurs
du
fameux
"Pacte
de
Famine"
destiné
suivant
les
Révolutionnaires,
à
affamer
le
peuple, et d'avoir, pour augmenter la disette, détourné d'énormes quantités de blé, qu'il aurait fait jeter dans les étangs de sa propriété de Gambais.
Il fut arrêté, jugé et guillotiné le 23 novembre 1793.
Mais
fait
curieux,
de
L'Averdy
ne
figure
pas
dans
le
contrat
d'acquêt
(Biens
acquis
au
cours
du
mariage
et
appartenant
aux
deux
époux)
du
Puy
du
Fou,
du
17 janvier 1791.
Ce fut un de ses gendres, le marquis de Belbœuf qui fut porté comme acquéreur.
Monsieur de L'Averdy eut trois filles :
1°) Catherine-Elisabeth, mariée à Arnault de la Briffe,
2°) Angélique, mariée à Louis-François Godard de Belbœuf
(1757-1832),
3°)
Mélanie,
épouse
de
Louis
Henri
de
Sesmaisons
(1751-1830)
,
explorateurs,
comme
nous
l'avons
déjà
écrit,
des
soi-disant
souterrains
du
Puy
du
Fou
après
la
Révolution.
De
L'Averdy
ne
résidait
pas
au
Puy
du
Fou,
mais
au
château
de
Gambais,
près
de
Montfort
l'Amaury.
Pendant
ce
temps-là,
le
Puy
du
Fou
était
habité
et
administré
par deux hommes totalement différents : le
Sénéchal et le Notaire.
Le Sénéchal était un officier féodal ou royal et rendait la Justice dans toute l'étendue de la Baronnie et administrait les domaines de son Seigneur.
Depuis 1780, c'était Charles-Joachim Girault de la Limouzinière qui remplissait ces fonctions.
Le Notaire était Gabriel-Vincent Chenuau
(1755-1821)
.
La Guerre de Vendée fit de ces deux hommes, des ennemis.
Le
premier,
Charles-Joachim
Girault
de
la
Limouzinière
était
né
en
1742
à
La
Ferrière,
près
de
La
Roche
sur-Yon
et
avait
épousé
le
9
mai
1780
au
Tallud-Sainte-
Gemme,
Jeanne-Charlotte
Merlet,
de
Saint-Paul-en
Pareds,
sœur
de
Merlet
qui
fut
Préfet
de
la
Vendée
à
la
fin
de
la
Révolution,
et
vint
cette
même
année
1780
s'installer au Puy du Fou dont il devint le Sénéchal.
Les
Girault
appartenaient
à
cette
bourgeoisie
vendéenne
que
nous
retrouvons
en
ce
Haut-Bocage
exerçant
de
multiples
charges
de
judicature
(chargé
de
rendre
la
justice)
.
Quand éclata l'Insurrection Vendéenne, Girault opta résolument, dès le premier jour, pour le mouvement
insurrectionnel.
Il s'efforça de protéger le domaine du Puy du Fou de la rapacité de Chenuau.
Dès 1793, il fit partie du premier, puis du second Comité Contre-révolutionnaire des Epesses, mis en place par l'Etat-major des Armées Vendéennes.
Au sein de ce Comité, il prendra des initiatives qui lui vaudront la haine du suivant.
Gabriel
Vincent
Chenuau
(1755-1821),
notaire
du
Puy
du
Fou,
était
né
aux
Epesses
en
1776,
de
René
Vincent
Chenuau,
notaire
et
procureur
de
la
Baronnie
des
Epesses, et épousa Charlotte Martineau, parente du
célèbre proconsul qui révolutionna Saint-Fulgent.
Dès le début, Chenuau se lance à fond dans les idées révolutionnaires, multiplie les persécutions contre les
habitants restés fidèles à leur Religion.
Il devint aux Epesses, l'émule du proconsul Jean-Baptiste Carrier
(1756-1794),
de Nantes, et ses victimes y furent nombreuses.
Pendant que sa fortune à la faveur des acquisitions des Biens Nationaux, devint considérable.
Parmi ses victimes, il faut compter Charles-Joachim Girault, de la Limouzinière, dernier sénéchal du Puy du
Fou.
Si
bien
que
lorsque
l'insurrection
éclata,
il
fut
pris
par
les
Vendéens
et
emprisonné
aux
Herbiers.
Là, Charles-Joachim
Girault
et
cinq
autres
Membres
du
Comité
Royaliste
des
Epesses,
Fuseau,
Rayneteau,
Lerin,
Brondit
et
Brousseau,
forcèrent
Chenuau
à
leur
remettre
la
somme
de
10.440
livres,
provenant
de
la
vente
faite
par lui, de biens et objets mobiliers saisis nationalement sur Joseph-Gabriel Grignon
(1735-1805),
marquis de Pouzauges.
Somme qu'ils remirent au Général de Donissan
(1737-1794),
commandant en second de l'Armée Vendéenne.
Il réussit après cette restitution forcée à obtenir sa liberté.
Il se réfugia avec sa famille, sous la protection de l'Armée Républicaine cantonnée à La Châtaigneraie.
Là, tant son zèle révolutionnaire était grand, qu'il réussit à se faire élire Administrateur du District de La
Châtaigneraie.
Girault,
jusqu'à
la
fin
de
1793,
officiellement,
puis
clandestinement,
continua
à
administrer
le
domaine
du
Puy
du
Fou,
mais
Chenuau
ne
pardonnait
pas
cette
restitution forcée des 10.440 livres que Girault et les
habitants des Epesses considéraient comme de l'argent volé.
Nous arrivons au temps des JUGEMENTS et EXECUTIONS
Dès
le
début
de
novembre
1793,
alors
que
l'Armée
Vendéenne
bataillait
Outre-Loire,
les
révolutionnaires
locaux
demandèrent
aux
troupes
républicaines
cantonnées à Cholet d'opérer une descente vers les Epesses
afin de purger cette commune des éléments contre-révolutionnaires.
Le
8
novembre,
le
citoyen-lieutenant
Baron,
Garde-magasin
de
la
garnison
de
Cholet
répondant
à
leur
appel
était
aux
Epesses
et
Chenuau
lui
remit
une
liste
de
26
habitants de cette commune que Baron fit arrêter
immédiatement.
Sur cette liste figurait le Sénéchal Girault.
Ces 26 habitants, sauf Girault, qui réussit à se cacher, furent envoyés à la Commission Militaire de Saumur
qui les jugea et les fit exécuter.
Et le 13 novembre 1793, Chenuau écrivait à Baron de retour à Cholet :
"Il nous faudrait encore Girault. On m'a assuré qu'il était caché à la métairie de Roche-Neuve, commune de Saint-Malo-du-Bois ...".
Mais Girault était introuvable.
Une
de
ses
cachettes
était
la
métairie
de
la
Garouflère
sur
la
route
d'Ohambretaud,
non
loin du Puy du Fou, qu'il administrait toujours.
Pendant
que
Chenuau
régnait
en
maître
sur
le
territoire
des
Epesses,
les
sinistres
Colonnes
Infernales
lancées
contre
la
Vendée
par
la
Convention
apeurée,
commençaient
leur
œuvre
de
destruction.
L'une de
ces
Colonnes,
celle
de
Boucret
venant
de
Mallièvre
et
des
Châtebliers
Châteaumur,
envahit
les
Epesses
au
soir
du
26 janvier 1794, sous la pluie et la neige.
Le
lendemain
et
les
deux
jours
suivant,
aux
Epesses
on
tue,
on
viole,
on
incendie,
on
jette même les femmes
et les enfants dans des fours enflammés.
Et le Puy du Fou subit le sort commun.
De
la
Garouflère
où
il
se
cachait,
le
sénéchal
Girault
pouvait
contempler
avec
douleur
l'incendie dévorer le
beau domaine qu'il administrait.
Nous arrivons à l'incendie du château.
Certains ont écrit que le riche mobilier du château devint à cette occasion, la proie des flammes.
Rien ne prouve qu'il fût meublé à cette époque.
Un nouveau propriétaire venait de l'acquérir.
Il n'y vint probablement jamais et n'eut certainement pas le temps de le meubler.
Ce fut probablement un château vide qui flamba.
Monsieur de L'Averdy résidait en son château de Gambais et à Paris où l'appelaient de multiples charges.
Et puis le Puy du Fou ne brûla qu'en partie.
Certainement le grand corps de logis aujourd'hui en ruines, mais pas l'aile gauche.
Et
même
le
Chartrier
(collection
des
documents)
,
les
titres
de
propriété,
les
livres
de
comptes
du
domaine
restèrent
enfermés
dans
des
placards,
dans
le
pavillon
du
XVème
siècle
qui
se
trouve
à
l'extrémité
de
l'aile
dite
de
l'Orangerie
et ce jusque vers 1949 date de leur transfert aux Archives Départementales de la Vendée.
Charette
et
Sapinaud
à
la
tète
des
quelques
hommes
restés
au
pays
ou
revenus
d'Outre-Loire,
s'opposèrent
vigoureusement aux Colonnes Infernales.
Un
peu
de
tranquillité
régna
de
nouveau
sur
le
Bocage
et
Charles-Joachim
Girault
reprendra
peu
à
peu
ses
fonctions de Sénéchal du Puy du Fou. Le 27 mai 1794, il s'occupait encore de l'administration du domaine.
Pas
pour
longtemps,
car
au
cours
d'une
expédition
des
amis
de
Chenuau
dans
le
bourg
de
Chambretaud,
Joachim
Girault était massacré.
La
date
exacte,
on
ne
la
connaît
pas,
mais
son
décès
est
mentionné
sur
la
liste
des
victimes
établie
le
19
juin
1794,
par
l'abbé
Gabard,
curé
de
Chambretaud.
Ce
fut
le
dernier
Sénéchal
du
Puy
du
Fou,
et
l'année
suivante,
le
nouveau
propriétaire
envoie
de
sa
Normandie,
un
régisseur,
Gilles
Benoit
Lelièvre,
qui
devint
parent
et
ami
de
Chenuau
(1755-1821).
Et
là,
ce
qui
prouve
que
le
Puy
du
Fou
ne
fut
pas
totalement
incendié
par
la
Colonne
Infernale
de
Boucret,
ce
fut
la
construction ordonnée par le marquis de Belbœuf pour loger Lelièvre, d'une petite maison à
l'extrémité du grand corps de logis.
Elle
était
presque
terminée,
lorsque
celui-ci
arriva
au
Puy
du
Fou
et
voyant
que
l'aile
gauche
n'avait
pas
été
détruite,
préféra
y
aménager
son
logement,
qui
fut
celui
de tous ses successeurs, jusqu'au milieu du XXème
siècle.
Puis pendant les derniers soubresauts de la Vendée, le Puy du Fou fut le théâtre d'un combat entre
Vendéens et Républicains.
Le général Travot écrivait le 9 novembre 1799, que la Guerre de Vendée était terminée.
C'était faux puisque le dernier épisode se déroula au Puy du Fou.
Les
armées
vendéennes
avaient
été
écrasées
aux
Aubiers
et
seul
Joseph-Gabriel-
Toussaint
Grignon,
marquis
de
Pouzauges,
dernier
chef
de
l'Armée
du
Centre,
continua
la
lutte.
A
la
tête
de
huit
cent
hommes,
le
13
novembre
1799,
il
battra
à
plates
coutures
à
La
Flocellière l'armée
républicaine cantonnée à Pouzauges.
Le lendemain, il se dirige vers le Puy du Fou en passant par les Epesses.
Les
républicains
battus
la
veille
à
La
Flocellière,
renforcés
d'une
petite
troupe
venue
de
La
Châtaigneraie, le
poursuivent.
Grignon
a
laissé
une
douzaine
d'hommes
aux
Epesses
avec
mission
d'attirer
les
ennemis
sur le gros de sa
troupe embusquée dans les bois du Puy du Fou.
A la vue des Républicains, les hommes de Grignon s'enfuient.
Les
premiers
les
poursuivent
et
tombent
dans
l'embuscade
tendue
par
les
Vendéens
dans
le bois du Puy du Fou.
Ce combat dure environ un quart d'heure, mais une trentaine de Bleus, dont le capitaine qui les commandait sont tués, les autres s'enfuient.
Ce
fut
la
dernière
victoire
Vendéenne.
Les amis
de
Chenuau
diront
plus
tard
que
les
Bleus
faits
prisonniers,
furent
massacrés
par
les
Vendéens
dans
le
bourg
des
Epesses.
Quatre jours plus tard, le marquis de Grignon tombera dans une embuscade au bourg de Chambretaud.
La Guerre de Vendée était terminée.
Et la vie reprit peu à peu au Puy du Fou.
Clément-François-Charles
de
L'Averdy
(1724-1793),
le
guillotiné
du
23
novembre
1793
avait
eu
trois
filles,
dont
l'une
mariée
en
1783
au
marquis
Louis-François
Godard
de
Belbœuf
(1730-1808),
qui
ayant
servi
de
prête-nom
à
son
beau-père
pour
l'achat
du
Puy
du
Fou,
devint
peu
à
peu,
par
suite
de
rachats
à
ses
sœurs
:
Mesdames de la Briffe et de Semaisons, l'unique propriétaire du domaine.
Les Belbœuf habitaient le château du même nom près de Rouen et une active correspondance s'échangeait
entre eux et le régisseur Lelièvre.
Il
y
est
question
de
fermages
qui
rentrent
peu,
de
la
restauration
des
métairies
endommagées
par
la
Guerre
de
Vendée
:
le
Grand
Bignon,
la
Garouflère,
la
Ménantrie, la Jaubretière, le Pressou, Yagues, le Fossé.
Devenu
inutile,
restreint
à
un
rôle
de
symbole
déformé
dans
l'esprit
des
volontaires
parisiens,
le
château
ne
pouvait
être
qu'une
cible
facile
et
sans
grand
danger
pour les incendiaires.
Puis, destin commun aux chefs-d'œuvre en péril, il offrit ses cicatrices aux villageois ayant leur foyer à
construire ou à reconstruire.
Triste dépeçage justifié par les nécessités d'un pays exsangue aux survivants hagards.
Mais
les
Vendéens,
peuple
secret,
peuple
généreux
et
méfiant,
se
renfermeront
derrière
une
pudeur
qui
en
fait
des
géants
et
ne
parleront
plus
de
ce
qu'ils
n'oublieront jamais.
La
nuit
du
24
au
25
janvier
1799,
sous
l'effet
d'un
tremblement
de
terre,
ces
pavillons
se
sont
écroulés
comme
de
nombreux
édifices,
églises
et
autres
ébranlés
en
Vendée.
En
1810,
M.
Poëy
d'Avant
(1792-1864),
visitait
ces
ruines
et
il
y
voyait
quelques
vestiges
de
tours
qu'il
nommera
'Pavillon
anglais",
ou
Pavillon
de
renaud
du
Puy
du
Fou".
Pavillon "anglais", pavillon de "Renaud du Puy du Fou", mais pourquoi ?
Peut-être en raison de la démolition du Vieux Puy du Fou par les Anglais.
Peut-être
aussi
du
fait
que
bon
nombre
de
matériaux
de
ce
Vieux
Puy
du
Fou,
probablement
construit
par
Renaud,
servirent
à
la
construction
de
ce
nouveau
château.
Comme
il
est
dit
en
plusieurs
aveux,
notamment
en
celui
du
9
janvier
1784,
rendu
à
Mortagne
pour
le
Vieux
Puy
du
Fou
et
ses
dépendances
"Lequel
dit
chasteau
nouveau a été bâti et construit d'après les démolitions dudit vieux château du Puy du Fou".
Il en reste aussi le bâtiment carré, qui se voit en entrant dans la cour du
Puy du Fou; à gauche, flanqué de deux tours à pans coupés.
L'une renferme un escalier desservant les étages.
Ce
bâtiment
fortement
remanié
conserve
sa
porte
en
plein
cintre,
et
à
l'intérieur,
un
ou
deux
corbelets
(pièce
de
bois
ou
de
pierre
en
saillie
sur
un
mur)
semblant
provenir
de
l'ancien château.
Le mur semble avoir été refait à une époque relativement récente.
A
l'intérieur,
dans
un
angle,
une
porte
dont
la
feuillure
prouve
qu'elle
devait
desservir
une partie de
bâtiment aujourd'hui disparue.
Puis
une
génoise
(fermeture
d'avant-toit
formée
de
plusieurs
rangs
pour
éloigner
les
eaux
de
ruissellement
de
la
façade)
faite
de
tuiles
renversées,
doit
dater
de
la
restauration survenue après le tremblement de terre
ce 1799.
Une
partie
des
murs
de
la
grande
galerie
proviennent
probablement
du
château
du
15ème,
comme
la
petite
tour
carrée
à
mâchicoulis,
qui
se
trouve
près
du
portail
actuel
et
l'éparons
de
l'angle
extérieur
Sud-est,
qui
ont
toutes
les
apparences
des
constructions du 15ème siècle.
Ce
château
devait
être
doté
de
souterrains,
comme
tous
les
châteaux
défensifs
de
cette époque.
L'un d'eux traverse la cour, allant du grand corps de logis vers le porche d'entrée de la cour.
Tout un
réseau
d'égouts,
de
passages
souterrains
passe
sous
les
bâtiments
actuels
et
semble
aboutir
à
la
dénivellation
de
terrain
bordant
la
grande
galerie
à
l'extérieur.
Certains écrits mentionnent deux souterrains dont l'un se dirigerait vers l'Ouest, l'autre vers l'Est.
Mais cela est une autre histoire.
P. Lelièvre y découvrait la base de quelques tours "dénotant l'architecture militaire du Xème ou du XIème
siècle.
Pendant un siècle et demi, les murs du Puy du Fou braveront un destin scellé d'avance.
Le 30 août 1813, Monsieur de Belbœuf écrit :
"Je n'ay pas vu la grande armoire du Puy du Fou.
Je vous exhorte à avoir bien soin des papiers, de l'ouvrir dans les beaux temps, pour les bien sécher et conserver..."
.
Son beau-frère, Monsieur de la Briffe étant devenu veuf, Madame de Belbœuf écrit à Lelièvre :
"Monsieur de la Briffe est remarié à Mademoiselle de Canclaux ...
Elle est riche aujourd'hui et le sera encore
beaucoup plus à la mort de son père qui a 76
ans.
L'auteur a été général de la République dans la Vendée.
Avez-vous quelques moyens de savoir comment il s'y est conduit, ceci pour moi seule...".
Canclaux
(1740-1817)
fut un adversaire acharné des Vendéens.
Du
mariage
Belbœuf
-
de
L'Averdy
naquirent
quatre
enfants
dont
Antoine-Louis-René-
Joseph, et
Augustine-Elisabeth, qui épouse en 1818, Alexandre Huchet de Quennetain.
Ils
se
partagent
le
domaine
du
Puy
du
Fou
et
en
1851,
Antoine
Godard
de
Belbœuf
vend
sa
part,
soit
le
Puy
du
Fou,
les
ruines
du
château
de
Mallièvre
et
une
dizaine
de
métairies aux alentours, à son neveu Ange
Louis-Alexandre Huchet de Quennetain.
C'est ce dernier qui entreprit la restauration du château.
Il fit
reconstruire
la
salle
des
gardes,
la
chapelle
et
le
grand
degré,
en
confia
l'exécution
à un architecte nantais, Monsieur Fraboulet, qui ne respecta pas le
plan
primitif,
puisqu'il
ajouta
à
ce
bâtiment,
sur
l'arrière,
un
pavillon
supplémentaire
et une haute toiture d'ardoises.
Il
s'y
ruina
presque,
puisqu'à
l'époque
ces
travaux
lui
coûtèrent
plus
d'un
million,
somme énorme pour le temps, mais cette partie était sauvée de la ruine.
En
1881,
Octave
de
Rochebrune
(1824-1900)
voyait
lui
aussi
une
forme
carrée
avec
tours
aux
angles,
et
les
traces
de
deux
fossés
concentriques,
dont
le
second
pouvait
se
remplir d'eau à volonté au moyen d'une chaussée.
En
1892,
l'abbé
Pondevie,
auteur
des
Chroniques
Paroissiales
du
Diocèse
de
Luçon,
écrivait :
"C'est une enceinte en forme de carré long irrégulier, avec tours aux angles.
Elle semble être du XIIIème ou du XIVème siècle.
Un
premier
fossé
l'entourait,
plus
bas
un
système
défensif
était
complété
par
un
second
fossé, plus large,
rempli d'eau à volonté au moyen d'une chaussée ".
Le
Puy
du
Fou
resta
dans
la
famille
de
Quennetain
jusqu'en
1949,
date
à
laquelle
il
fut
vendu à Maître
Savard, notaire à Bressuire.
Il
fit
de
nombreux
aménagements
pour
rendre
l'aile
gauche
habitable
et
remit
en
eau
le
grand étang dans
lequel se reflète la façade arrière.
Il rétablit l'étang à la place qu'il occupait au pied de la terrasse.
La
cour
d'honneur
est
réhabilitée
et
une
partie
du
bâtiment
est
remis
à
neuf
pour y être habités.
En 1962, le château sera, Louis Savard, sous l'impulsion de classer comme monument historique.
En 1974, sous l'impulsion de Jacques De Villiers, il fut acquis par le Département de la Vendée en fit le Centre Culturel de la Haute-Vendée.
La restauration est entreprise.
Le Puy du Fou est sauvé et voilà terminée l'histoire de ce haut-lieu, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours.
Il
faut
attendre
l'année
1977
(année
de
mise
en
vente
du
château)
,
pour
qu'il
soit
remarqué
par
un
architecte
des
Bâtiments
de
France
qui
en
signala
l'intérêt
au
Conseil général de Vendée.
A cette date, le Puy du Fou est une carcasse décharnée.
D'un aspect imprévu, le château enchante l'œil.
Face au couchant, des pans de murs ruinés baignent dans des flaques de boue.
Le granit roux des Mauges aux gros grains de mica, les tuiles creuses, les briques roses, donne à l'ensemble une allure sobre et élégante.
Les tons pastel des tuiles et des briques tranchent habilement sur le granit.
Et lorsque le soleil, dans un ciel bleu de mer, éclaire sa façade, le Puy du Fou rayonne de pureté.
Les blocs de granit s'écartent sous la
pression des racines sauvages et des paquets d'herbes folles.
Sur
les
caissons
Renaissance,
une
pellicule
verte,
algue
ou
champignon,
retenait
une
humidité sournoise qui pénétrait la pierre.
La grande cour intérieure donnait des allures de grosse ferme.
Les
blocs
de
granit
s'écartaient
sous
la
pression
des
racines
sauvages
et
des
paquets
d'herbes folles.
Lente
érosion
des
souvenirs
et
des
pierres,
jusqu'au
jour
où
en
1978,
une
nouvelle
aventure attend le château dont le nom secret provoque à lui seul l'enchantement.
Le
13
juin
1977,
un
jeune
homme
de
vingt-sept
ans
frappe
à
la
porte
de
l'aile
gauche
du
château
et
Gustave,
le
régisseur,
lui
ouvre
la
porte
de
ce
qui
deviendra
la
toile
de
fond
du plus beau spectacle au monde
(la cinéscénie).
Une
multitude
d'actions
et
de
créations
allait
éclore
spontanément
du
savoir
faire
des
acteurs
du
"Spectacle
du
Puy
du
Fou",
car
le
creuset
est
né
dans
les
textes
et
les
images
de
ce
fils
du
pays,
Philippe
de
Villiers,
et
grâce
à
l'Association
pour
la
mise
en
valeur
du
château et du pays du Puy du Fou.
Les
répétitions
de
1978
prouvaient
immédiatement
qu'un
nouveau
mode
d'expression
est
né.
Il
s'appellerait
"Cinéscénie",
cinéma
vivant
de
plein
air,
en
direct,
animés
par
des
acteurs
qui se souviennent
et refont les gestes de leurs anciens.
Fêtes
et
labeurs
autour
des
quintaines
du
Moyen
Age,
danses
et
travaux
des
champs
le
long
du
passage
légendaire
de
François
Ier
au
château,
saines
colères
pour
la
liberté
de
croire et de penser, modernismes et
guerres mondiales.
Fil
conducteur,
témoin
immuable
de
tous
les
temps
:
le
paysan
vendéen,
Jacques
Maupillier.
Un
symbole
parmi
des
millions
d'ancêtres,
hier
la
faux
à
la
main
et
aujourd'hui
manipulant des
amplificateurs, des lasers, des jets d'eau ou de géantes brioches.
Mais revenons un court instant à François 1
er
du Puy du Fou et à Anne BOUER.
Tout
deux
ont
eu
sept
enfants
dont
Catherine
du
Puy
du
Fou
qui
se
maria
le
5
septembre
1516
avec
un
certain
"Robert
II
de
Villiers",
branche
portant
le
nom
qui
s'éteindra
en
1833.
Probablement un petit clin d'œil de l'histoire !!