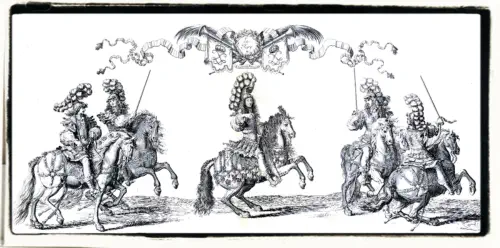L'art
équestre
tire
ses
racines
de
la
Grèce
Antique,
époque
où
l'on
a
cherché
l'affinement
du dressage des chevaux à des fins guerrières.
Les
Romains
firent
de
même
avec
leur
cavalerie
pour
les
grandes
campagnes
d'Afrique
et
d'Espagne.
Mais
l'équitation
en
tant
qu'art
n'a
véritablement
pris
naissance
qu'après
la
renaissance
Italienne,
abandonnant
l'objectif
guerrier
au
profit
de
l'esthétisme,
ainsi
dans
tous
les
pays
du
monde
civilisé
naquirent
des
écoles
et
des
académies
équestres
pour
enseigner
et
perpétuer cet art, universellement considéré comme noble.
L'art
équestre
peut
se
définir
comme
étant
la
capacité
d'apprendre
à
un
cheval,
par
la
douceur,
la
logique
basée
sur
les
lois
naturelles
de
l'équilibre
et
de
l'harmonie,
à
se
soumettre
avec
plaisir
et
fierté
à
la
volonté
de
son
cavalier
sans
dénaturer
en
aucune
manière sa façon de se déplacer.
Pour
pénétrer
"l'âme"
de
l'équitation
ique,
il
faut
essayer
de
comprendre
la
philosophie
du
classicisme et de son époque du XVIe au XVIIIe siècle.
A
cette
période,
l'art
représentait
ce
qui
était
précis,
ique,
il
appartenait
à
la
réalité,
il
reflétait
la
beauté
et
l'ordre
de
la
nature,
il
était
toujours
soumis
aux
lois
de
l'équilibre
et
de
la légèreté.
C'était le règne de la symétrie et de la logique.
Il
est
ainsi
plus
aisé
de
comprendre
que
l'équitation
académique
française
dû
sa
naissance à l'esprit ique qui atteignit son apogée à la Cour de Versailles sous Louis XIV.
À
la
Cour
de
Louis
XIV,
des
carrousels
extravagants
d'inspiration
italienne
furent
organisés et devinrent très populaires.
La
gravure
de
CHAUVEAU
(1613-1676)
faite
en
1670
montre
le
roi
habillé
en
romain
dans "une côte d'argent brodée d'or".
En
1680,
le
Roi-Soleil
s'installait
à
Versailles
et
y
organisait
ses
écuries
avec
toute
la
splendeur qu'il apportait à ce qu'il touchait.
L'esprit
ique
apparaissait
dans
l'art,
l'architecture,
la
sculpture,
la
musique,
l'aménagement des jardins et des parcs, l'équitation ...
L'équitation ique était enseignée, au même rang que la littérature, la poésie, la musique.
L'école
de
Versailles,
plus
qu'une
localisation
géographique,
représentait
une
philosophie
de
l'équitation
qui
était
en
perpétuelle
quête
de
la
perfection,
à
la
recherche
de
l'harmonie
cheval-cavalier, permettant l'expression esthétique de l'art.
A
toute
philosophie,
des
esprits,
des
maîtres
et
celui
qui
personnifia
l'école
de
Versailles,
qui
fut
le
véritable
artiste
équestre
qui
inspira
par
ses
écrits
(notamment
"l'école
de
cavalerie"
publié
en
1729)
l'équitation
ique
jusqu'au
monde
actuel
de
la
haute
école,
s'appelait François ROBICHON de la Guérinière (1688-1751).
Il est souvent considéré comme le plus grand écuyer français de tous les temps.
Il
fut
certes
inspiré
par
d'autres
maîtres
français
comme
Salomon
de
la
BROUE
(1530-
1610)
écuyer
d'Henri
III,
Antoine
de
PLUVINEL
(1555-1620)
écuyer
de
Louis
XV,
qui
eux-
mêmes furent influencés par l'Italien Gianbatista PIGNATELLI (1525-1558).
Mais,
c'est
lui,
de
l'avis
des
historiens
d'art
équestre,
qui
amena
l'équitation
ique
à
son
apogée,
sa
conception
du
dressage
et
sa
parfaite
connaissance
de
la
psychologie
des
chevaux étaient et restent novatrices.
Même
si
les
circonstances
ne
l'ont
pas
amené
au
titre
de
grand
écuyer
de
France
auprès
du
Roi-Soleil,
l'écuyer
en
titre,
le
Prince
Charles
de
LORRAINE,
fut
totalement
à
l'écoute
de ses conseils.
Son
art
fut
prolongé
à
Versailles
par
des
écuyers
comme
Monsieur
de
NESTIER
(1684-
1754),
écuyer
de
Louis
XV
ou
Claude
BOURGELAT
(1712-1760),
écuyer,
médecin
fondateur des écoles vétérinaires.
Mais
la
pression
des
militaires
et
l'évolution
des
techniques
de
combat
qui
considéraient
l'équitation
de
manège
comme
une
folie
inutile,
et
surtout
le
cataclysme
de
1789,
changèrent
du
tout
au
tout
la
conception
de
l'équitation,
et
sa
vision
artistique
faillit
disparaître.
Le
seul
cavalier
qui
apporta
un
embellissement
à
l'équitation
ique
de
la
Guérinière
fut
François BAUCHER (1796-1873).
Il
se
produisait
à
travers
des
spectacles
que
l'on
peut
rapidement
comparer
au
cirque
actuel.
Il "exportait" ses connaissances, ne trouvant qu'à l'étranger de l'intérêt pour ses travaux.
De
nos
jours,
les
préceptes
de
Monsieur
de
LA
GUERINIERE
inspirent
les
écoles
d'art
équestre
étrangères,
comme
au
Portugal,
l'école
de
Lisbonne,
en
Espagne
avec
l'école
de
Jerez
ou
encore
la
plus
prestigieuse
école
de
Vienne,
où
sa
méthode
fait
figure
de
règle d'or.
On
peut
remarquer
que
la
France
a
été
le
pays
qui
magnifia
l'équitation
ique
jusqu'à
l'amener
à
l'état
d'art,
et
par
une
vague
dévastatrice
l'a
détruite,
oubliée
ou
presque,
laissant à d'autre la jouissance d'un véritable trésor du patrimoine français.
En
France,
au
lendemain
des
guerres
napoléoniennes,
la
cavalerie
française
est
décimée.
Dès
1815,
pour
reformer
les
troupes
à
cheval,
une
"école
des
Troupes
à
cheval"
fut
créée
à Saumur avec pour mission de former des instructeurs pour tous les corps de Cavalerie.
Face
à
l'urgence
de
cette
remonte
en
cavaliers
et
en
chevaux,
on
y
constitue
un
corps
d'enseignants
composé
de
quelques
grands
écuyers,
civils,
issus
des
Manèges
de
Versailles, des Tuileries ou de Saint-Germain.
Celle-ci
est
fondée
en
1825,
au
départ,
sur
les
principes
académiques
hérités
de
l'école
de
Versailles,
puis
sous
l'autorité
du
comte
d'Aure,
elle
évolue
vers
une
forme
plus
naturelle et plus hardie.
Enfin,
les
apports
techniques
de
François
BAUCHER
sont
étudiés
de
près
par
cette
communauté militaire qui cherche en permanence à améliorer sa technique.
Dans
ses
spectacles
"Mousquetaire
de
Richelieu"
et
"Cinéscénie",
le
Puy
du
Fou
renoue
avec les traditions de cet art, en présentant des figures équestres de qualité.
Notons
particulièrement
un
passage
unique
au
monde,
qui
met
en
scène
une
chorégraphie
d'un
dresseur
et
ses
chevaux
dans
le
noir
(éclairé
par
des
tubes
ultraviolets).
Un
cheval
perd
normalement
tous
ses
repères
dans
le
noir
et
ce
numéro
a
nécessité
près
de deux ans de travail.