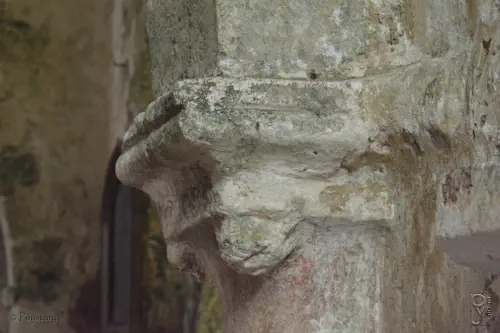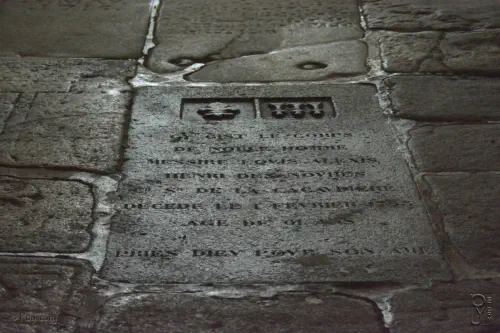Si
pittoresque
dans
son
cadre
de
cyprès,
avec
son
lourd
clocher,
ses
étroites
fenêtres,
son
dallage
de
pierres
tombales,
mais
bien
délabrée,
ses
murs
verdis,
ses
voûtes
fissurées...
fut d'abord un prieuré fondé par les moines de Luçon ou de Saint-Michel en l'Herm.
De prieuré Saint-Jean, elle devient prieuré Notre-Dame ensuite église Notre Dame.
On
est
tenté
d'en
faire
un
édifice
de
la
première
époque
romane,
et
cependant
certains
détails
incitent
à
la
rajeunir
quelque
peu,
ne
seraient-ce
que
sa
construction
en
moellons
de moyen appareil impeccablement alignés et ses arcs en tiers-point accentué.
On
n'a
aucune
donnée
sur
le
plan
primitif
du
chœur,
cependant
l'Église
primitive
apparaît
dans les archives entre 1047 et 1118 comme la première église de Pouzauges.
Mais
il
est
bien
évident
que
la
travée
extrême,
avec
la
grande
baie
ogivale
à
rainures
du
chevet et les baies latérales est une construction du XIVe ou XVe siècle.
La voûte en berceau est d'une époque antérieure.
C'est
un
édifice
en
forme
de
croix
latine,
le
chœur
très
profond
étant
fortement
incliné
vers
le Nord.
Le transept, au centre du monument, supporte le clocher.
Dans
les
croisillons
s'ouvrent
les
absidioles,
simple
travée
chacune,
l'une
semi-circulaire,
l'autre à chevet droit.
La nef est éclairée par de longues baies en lancettes très étroites.
Toute
la
construction
(chœur,
nef,
croisillons,
transept)
est
recouverte
de
voûtes
en
berceau brisé.
La
décoration
est
sommaire,
à
peine
quelques
corbelets
aux
figures
grimaçantes
ou
quelques chapiteaux ornés de feuillages grossièrement sculptés.
Le
clocher
est
une
tour
carrée
dominant
hautement
l'église
de
sa
double
rangée
d'arcatures.
Les
inférieures
sont
aveugles,
mais
la
rangée
supérieure
présente
dans
chacune
de
ses
faces
une
ouverture
cintrée
médiane,
flanquée
de
deux
plus
petites
placées
à
un
niveau
plus élevé.
L'ensemble,
suivant
les
dires
de
R.
Vallette
et
L.
Charbonneau-Lassay,
forme
un
des
moins
lourds
et
des
mieux
proportionnés
parmi
ces
clochers
carrés,
sobres
et
sévères
comme
des
donjons,
que
l'architecture
monastique
répandit
dès
le
XIe
siècle
dans
tout
le
Bas-Poitou et qui furent si souvent copiés depuis.
Cette
église
est
remarquable
aussi
par
le
nombre
considérable
de
pierres
tombales
(99)
qui forment le pavage.
Ces dalles proviennent du cimetière qui entourait l'église.
Aucune autre église n'en est aussi riche.
Taillées
et
sculptées
dans
le
dur
granit
du
pays,
elles
ont
traversé
les
siècles,
leur
relief
à
peine émoussé par le temps.
Les plus anciennes remontent au XIIIe siècle.
Certaines
ne
portent
qu'un
symbole
rappelant
la
qualité
du
défunt
:
bouclier,
épée,
lance,
ou bien calice, missel ouvert, croix plus ou moins ornée, ou encore un simple outil...
D'autres,
qui
sont
en
général
plus
récentes
et
ne
remontent
guère
au-delà
du
XVIe
siècle,
sont décorées d'épitaphes ou de blasons.
On peut voir aussi un superbe lavabo liturgique d'allure Gothique.
Enfin,
une
découverte
assez
récente
(1948)
vient
de
rehausser
encore
l'intérêt
de
cette
vénérable église.
Classée
Monument
Historique,
cette
église
est
l'un
des
rares
édifices
à
avoir
conservé
des
traces
de
polychromies
apportant
une
preuve
supplémentaire
que
cette
église,
comme
toutes les autres églises étaient peintes en polychromie à l'intérieur.
Des
peintures
murales
ont
été
mises
à
jour
dans
le
mur
Nord
de
la
nef,
racontant
l'histoire
de
S.
Joachim,
d'après
les
Évangiles,
Ancien
Testament
et
des
textes
apocryphes,
l'apparition
de
l'ange,
la
rencontre
d'Anne
et
de
Joachim
sous
la
Porte
dorée
et
la
Présentation de Marie au Temple...
Une
frise
sépare
ces
scènes
d'un
registre
supérieur
montrant
les
travaux
des
saisons,
mai, juin, juillet, août...
Il s'agissait d'attirer les fidèles par les images.
Elles
devaient
enseigner
les
grands
préceptes
bibliques
aux
fidèles
qui
étaient
dans
l'incapacité de lire en leur rappelant sans cesse leurs devoirs envers l'Église.