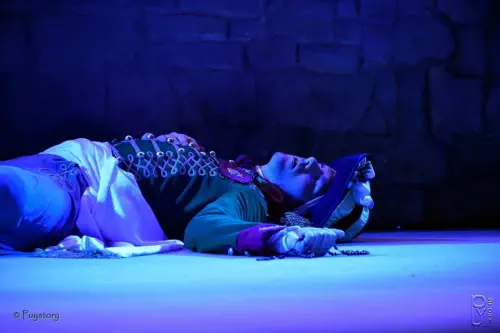On
appelle
"Vendée
militaire"
les
territoires
qui
se
soulevèrent
en
1793
contre
la
Convention
(Assemblée
constituante)
:
en
Anjou,
les
Mauges,
autour
de
Cholet
;
en
Poitou,
la
Gâtine,
le
Bocage
et
le
Marais
vendéen,
le
pays
de
Retz,
autour
du
lac
de
Grand-Lieu.
Ces
régions
de
pénétration
difficile,
coupées
de
haies
et
de
cours
d'eau,
forment
un
terrain favorable aux embuscades.
On
distingue
la
Vendée
militaire,
contrôlée
par
l'armée
catholique
et
royale,
des
pays
de
chouannerie
(Maine,
Normandie,
Bretagne),
où
les
royalistes
opérèrent
en
ordre
dispersé.
Si
les
premières
années
de
la
Révolution
ne
provoquent
aucun
rejet
de
la
part
de
la
paysannerie
locale,
l'opposition
entre
la
Vendée
et
Paris
se
noue
autour
de
la
persécution des prêtres réfractaires à la Constitution civile du clergé.
Cette répression donne lieu à des révoltes sporadiques.
L'exécution
de
Louis
XVI,
mais
surtout
la
conscription
forcée,
sont
à
l'origine
de
l'insurrection
qui
éclate
en
mars
1793
à
St-Florent-sur-Loire,
puis
qui
s'étend
rapidement
à toutes les Mauges angevines et au Bas-Poitou.
Dirigés
au
début
par
des
chefs
issus
du
peuple,
comme
Cathelineau,
colporteur
au
Pin-
en-Mauges,
ou
Stofflet,
garde-chasse
à
Maulévrier,
les
paysans
font
ensuite
appel
à
leurs "Messieurs".
Dans
les
Mauges,
les
gars
de
Beaupréau
vont
chercher
d'Elbée
et
ceux
de
St-Florent
le
marquis de Bonchamps.
Au
cœur
du
bocage
et
du
marais,
Sapinaud
et
le
chevalier
de
Charrette
conduisent
leurs
fermiers,
comme
en
Gâtine
le
jeune
châtelain
de
la
Durbelière,
La
Rochejaquelein,
et
celui de Clisson, Lescure.
Ces
"Brigands"
armés
de
faux,
de
fourches
et
de
quelques
fusils,
puis
d'armes
de
guerre
prises aux Républicains, sont groupés en paroisses.
Tous
portent
le
scapulaire,
une
étoffe
ornée
du
Sacré-Cœur
enflammé
surmonté
d'une
croix, que l'on passe sur les épaules et qui couvre le dos et la poitrine.
Le
drapeau
des
Vendéens
est
blanc,
semé
de
fleurs
de
lys,
et
porte
souvent
la
devise
"Vive Louis XVII".
La
base
de
leur
tactique
est
la
surprise,
les
bons
tireurs
enveloppent
la
force
adverse
et,
dissimulés dans les haies, déciment l'ennemi.
Puis tout le monde se jette à l'assaut au cri de :
"Rembarre ! Vive la Religion I Vive le Roi !".
En
avril
1793,
les
Bleus
(républicains)
ont
réagi
et,
malgré
un
grave
échec
à
Chemillé,
ont repoussé l'armée catholique et royale sur la Sèvre.
Puis celle-ci reprend l'avantage et s'empare de l'Anjou en juin.
Mais
son
premier
chef
Cathelineau
est
tué
lors
des
assauts
infructueux
contre
Nantes
et
d'Elbée prend alors le commandement.
La
menace
extérieure
des
armées
coalisées
étant
en
partie
levée,
la
Convention
s'inquiète de ce conflit intérieur qui lui semble le plus important.
L'armée
de
Mayence,
conduite
par
Kléber,
Westermann
et
Marceau,
est
envoyée
en
Vendée militaire.
Vaincue
d'abord
à
Torfou,
cette
armée
remporte
la
sanglante
bataille
de
Cholet
que
l'armée vendéenne essaie de reconquérir.
Lescure et Bonchamps sont mortellement atteints.
En se retirant sur St-Florent, Bonchamps, mourant, fait libérer des milliers de prisonniers.
Puis
l'armée
catholique
et
royale
passe
la
Loire,
dans
l'espoir
de
rejoindre
à
Granville
une flotte anglaise.
Elle
échoue
dans
cette
tentative,
les
déroutes
du
Mans
et
de
Savenay
finissent
de
désagréger ce qui en reste.
Décrétée par la Convention, la répression commence alors.
Elle
est
véritablement
effroyable
durant
l'hiver
1794,
s'accompagnant
d'exécutions
massives et de la destruction de la Vendée.
Deux
armées,
commandées
par
le
général
Turreau,
sont
divisées
en
colonnes
ayant
chacune un itinéraire précis.
La
mission
de
ces
Colonnes
infernales
est
d'exterminer
les
combattants,
les
femmes,
"sillons
reproducteurs",
et
les
enfants,
"futurs
brigands",
et
de
détruire
l'habitat
et
les
cultures.
Cependant,
au
cours
de
cette
année
1794,
la
Vendée
résiste
encore
et
mène
une
guerre
d'usure contre l'occupant.
Dans les Mauges, Stofflet tient la campagne et défait les Bleus sur plusieurs sites.
Dans
le
Marais
et
le
Bocage,
Charette
harcèle
les
républicains
par
de
petits
raids
inopinés.
Cette
guérilla,
la
mort
de
Robespierre,
l'action
pacificatrice
de
Hoche
font
qu'au
début
de
1795, la paix est signée avec Charette à La Jaunaye, avec Stofflet à St-Florent.
Quelques
mois
plus
tard
toutefois,
à
l'instigation
du
comte
d'Artois,
Charrette
et
Stofflet
reprennent la lutte.
Mais la Vendée est à bout de souffle et, le frère du roi ne secourant pas ses fidèles.
Hoche,
habile
et
généreux,
réussit
à
pacifier
la
région
en
obligeant
d'Hervilly
à
se
réfugier
dans la presqu'île d'Oléron.
Il assure la victoire de la République en juillet 1795.
En 1796, Stofflet, pris à côté de Jallais, est fusillé à Angers.
Charette,
capturé
à
la
Chabotterie,
subit
le
même
sort
à
Nantes
et
meurt,
le
29
mars
au
cri de :
"Vive le Roi !"