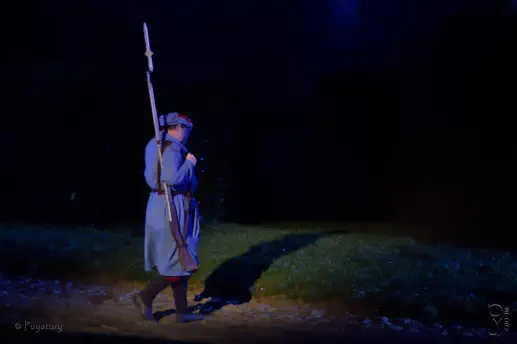Nous
commémorons
en
2018,
le
100ème
anniversaire
de
la
fin
de
la
Première
Guerre
mondiale 1914-1918.
Ci-dessous les étapes principales qu'a connu ce conflit appelé la :
"GRANDE GUERRE".
L'assassinat
le
28
juin
1914,
à
Sarajevo,
de
l'archiduc
héritier
d'Autriche-Hongrie
FrançoisFerdinand
par
un
étudiant
bosniaque
n'est
qu'un
prélude
tragique
à
la
Première
Guerre mondiale.
Le
23
juillet,
l'Autriche-Hongrie
envoie
un
ultimatum
à
la
Serbie,
pour
lui
déclarer
la
guerre
le 28 juillet.
Après
la
Russie,
avant
l'Allemagne
et
la
France,
le
Gouvernement
belge
décrète
le
31
juillet
la
mobilisation
générale
après
avoir
refusé
à
l'Allemagne
le
passage
de
ses
troupes
sur son territoire.
Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et le 3 août à la France.
Le 5 août, c'est au tour de l'Autriche-Hongrie de déclarer la guerre à la Russie.
Le 23 août, la Grande-Bretagne et le Japon déclarent la guerre à l'Allemagne.
Le
6
août
1914,
la
division
de
cavalerie
belge
repousse
à
Halen,
près
de
Diest,
quatre
régiments de cavalerie allemande.
C'est la fameuse "Bataille des Casques d'Argent".
Un front "Ouest" et un front "Est" se créent rapidement.
Après
avoir
violé
la
neutralité
belge,
l'armée
allemande
atteint
le
Nord
de
la
France
le
13
septembre
et
le
maréchal
Joffre
(France)
remporte
la
victoire
décisive
de
la
bataille
de
la
Marne.
Octobre-novembre
1914,
la
Bataille
de
l'Yser,
les
troupes
belges
et
alliées
arrêtent
la
progression des Allemands.
De
septembre
à
novembre,
un
front
continu
et
ininterrompu
de
750
km
se
stabilisera
entre
Ypres et la frontière suisse.
Lors
d'une
offensive
allemande
près
d'Ypres,
les
gaz
(Ypérite
ou
gaz
moutarde)
sont
utilisés pour la première fois le 22 avril 1915.
De
février
à
décembre
1916,
la
bataille
de
Verdun,
sans
doute
la
plus
violente
de
la
Grande Guerre, où les Français résistent aux lourdes offensives allemandes.
Selon
les
prévisions
allemandes,
la
bataille
devait
se
solder
par
un
coefficient
de
perte
de
1/5 en faveur de l'armée allemande.
L'épisode se termine victorieusement pour les Français.
Seul
grand
choc
naval
de
la
Première
Guerre
mondiale,
la
Bataille
du
Jutland
a
lieu
le
31
mai et le 1er juin 1916.
Les navires allemands tentent de briser le blocus pour rejoindre les mers libres.
Les
Britanniques
restent
maîtres
du
champ
maritime
malgré
une
apparente
supériorité
de
la flotte allemande.
Le 1er février 1917, Guillaume II décide d'intensifier la "Guerre sous-marine à outrance".
Les "U-boot" allemands coulent 3,5 fois plus de navires que les Anglais n'en construisent.
A partir de 1918, la construction navale américaine compensera les pertes.
Le 2 avril 1917, les États-Unis rejoignent les Alliés.
Le 6 avril, ils déclarent la guerre à l’Allemagne ("Remember the Lusitania 1").
Le 16 avril 1917, les Français montent près du Chemin-des-Dames, l'offensive de Nivelle.
Cette offensive se soldera le 4 mai par un échec désastreux pour les troupes françaises.
les 6 et 7 novembre 1917, la "Révolution d'octobre" se déclenche en Russie.
Le
3
mars
1918,
le
Traité
de
Brest-Litovsk,
traité
de
"paix
séparée",
est
signé
par
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, l'Empire Ottoman et la Russie soviétique.
Les
Allemands
peuvent
dès
à
présent
concentrer
toutes
leurs
forces
sur
le
front
de
l'Ouest.
D'avril à novembre 1918, l'épidémie de grippe espagnole fait 4.700.000 morts en Europe.
Rethondes,
le
11
novembre
1918
entre
5h20
et
5h30
du
matin,
l'Armistice
est
signée
entre les Alliés et l'Allemagne dans un wagon de chemin de fer à Compiègne.
Les clauses principales seront :
-
évacuation
de
la
France,
la
Belgique
et
le
Luxembourg
pour
le
26
novembre
et
de
la
rive
gauche du Rhin pour le 10 décembre.
- constitution d'une Pologne indépendante avec accès à la mer.
- renoncement à l'annexion de l'Autriche germanophone.
Les Anglais exigent l'abandon des colonies et la livraison de la flotte de guerre.
Le "CESSEZ LE FEU" aura lieu à onze heures le 11 novembre 1918.
Mais que reste-t-il de cette page de l'histoire ?
En
France,
la
commémoration
de
l'Armistice
(autrement
dit
de
la
fin
d'une
Grande
Guerre
qui
devait
être
la
"Der
des
Ders")
prendra
par
la
suite
une
place
importante
dans
la
vie
nationale,
avec
des
gerbes
déposées
chaque
année,
à
quelques
jours
de
la
Toussaint,
fait
du
hasard,
au
pied
des
monuments
aux
morts
de
chaque
commune
ce
jour
de
la
"Fête du Souvenir".
Des plaques commémoratives sont également installées dans les lieux publics.
Lors
des
cérémonies
du
11
novembre
commémorant
la
fin
de
la
Grande
Guerre
(1914-
1918),
on
rend
hommage
au
Soldat
inconnu
(Soldat
anonyme
enterré
sous
l'Arc
de
Triomphe
de
la
place
de
l'Étoile
à
Paris
représentant
symboliquement
tous
les
soldats
français morts pendant la Première Guerre mondiale).
En
France,
le
bleuet
est
le
symbole
de
la
mémoire
et
de
la
solidarité,
envers
les
anciens
combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins.
Au
Royaume-Uni,
le
coquelicot
est
le
symbole
utilisé
pour
honorer
les
soldats
tombés
au
combat.
Pourquoi cette fleur ?
Au
printemps
1915,
les
champs
flamands
qui
entouraient
les
tranchées
britanniques
étaient remplis de coquelicots.
Le
poète
et
militaire
canadien
John
McCrae
leur
dédie
alors
un
poème
baptisé
"In
Flanders fields".
"Nous ne dormirons pas, même si les coquelicots poussent. Dans les champs de
Flandre".
Et cette fleur devient le symbole des victimes de cette guerre.
Le traité de Versailles mettait fin à la Première Guerre mondiale.
Il
fut
signé,
le
28
juin
1919,
dans
la
galerie
des
Glaces
du
château
de
Versailles,
entre
l'Allemagne, d'une part, et les Alliés, d'autre part.
Le
traité
avait
été
préparé
par
la
Conférence
de
paix
(tenue
à
Paris,
du
18
janvier
1919
au
10
août
1920)
qui
élaborait
notamment
les
quatre
traités
"secondaires"
de
Saint-Germain-
en-Laye, du Trianon, de Neuilly-sur-Seine et de Sèvres.
Le
traité
de
Versailles
a
imposé
à
l'Allemagne
des
clauses
territoriales
(par
exemple,
la
restitution
de
l'Alsace-Lorraine
à
la
France
et
la
perte
de
toutes
les
colonies
d'Afrique
aux
mains
de
ses
rivales,
la
France
et
la
Grande-Bretagne
:
le
Cameroun,
le
Togo,
le
Tanganyika
et
le
Südwestafrika
ou
Namibie),
militaires
(p.
ex.,
le
réduction
des
armements
en
canons
et
en
avions
ainsi
que
des
effectifs,
la
démilitarisation
de
la
rive
gauche
du
Rhin,
la
surveillance
d'une
Commission
de
contrôle
interalliée)
et
économiques
(en
tant
que
responsable
du
déclenchement
de
la
guerre,
l'Allemagne
était
condamnée
à
payer le montant des dommages subis par les Alliés).
Dans
l'obligation
d'accepter
ces
dures
conditions,
l'Allemagne
a
considéré
le
traité
comme
un Diktat.
Dans
les
années
30,
les
conditions
de
ce
traité
deviendront
invivables
pour
les
allemands
et mèneront à la Deuxième Guerre mondiale.