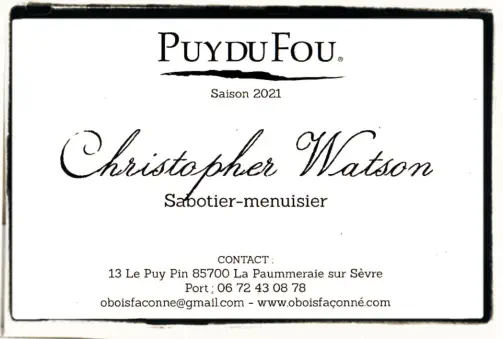Dans l'atelier de l'artisan règne une bonne odeur de menuiserie.
Au mur, des outils rudimentaire alignés comme à la parade.
Au
centre,
éclairé
par
les
fenêtres,
trône
"la
chèvre",
sorte
de
billot
de
bois
à
quatre
pieds
auréolé de copeaux blonds qui jonchent le sol.
L'artisan manie la hache, l'herminette et le paroir et dégrossit son morceau de bois.
Le bois se travaille demi-sec.
Abattu
en
vieille
lune,
dépouillé
de
son
écorce
et
débité
en
bille
d'un
mètre
de
long,
il
est
entreposé près de l'atelier.
Chacune
de
celles-ci
est
elle-même
sciée
en
trois
morceaux
correspondant
à
la
longueur
maxima des sabots.
Leur taille se donne en pouces et va du 8 1 /2 (22 cm) au 13 (34 cm).
Le
bûchage
s'effectue
à
l'aide
de
la
hache
à
bûcher,
appelée
aussi
hache
à
épaule
de
mouton.
C'est
un
outil
caractérisé
par
la
forme
très
particulière
de
son
manche
et
de
son
fer
décentré sur la gauche pour ne pas gêner le mouvement du sabotier.
Le talon est marqué d'une encoche et l'ébauche est fixée sur un billot.
La
mise
en
forme
est
commencée
à
l'herminette
pour
être
achevée
au
paroir,
sorte
de
long couteau à un manche fixé par une extrémité.
L'artisan taille, épluche, lime sans un raté.
Copeau après copeau, la forme émerge de sa gangue parfaitement équilibrée.
Le sabot est ensuite creusé à l'aide de gouges, tarières et autres cuillères diverses.
La
talonnette
sert
à
donner
l'arrondi
du
talon
tandis
que
la
rouannette
permet
de
planer
le
dedans.
La finition est assurée au racloir.
Il
est
alors
possible
de
les
décorer
et
de
les
teinter
au
brou
de
noix
ou
à
la
suie
ou
bien
encore de les vernir.
L'œuvre
terminée,
devant
tant
de
savoir-faire,
on
ne
peut
s'empêcher
de
penser
à
la
marionnette que "Gepetto" avait créée avant tant d'amour et à qui une fée donna la vie.
"Les belles dames, les gros bourgeois dédaignent mes sabots de bois.
Le roi peut bien se chausser de veau.
Moi
je
préfère
mes
durs
sabots,
sabots
de
frêne
taillés
chez
nous,
ils
m'ont
coûté
quatorze sous."
Imaginez un instant une armada de plus de mille sabots ...
Sabots
massifs
tirés
d'un
morceau
de
hêtre,
propres
à
naviguer
dans
la
boue,
sabots
pointus et coquets garnis de cuir, pour danser...
Sabots
qu'un
Maupillier
rageur
fait
claquer
comme
un
homme,
ou
lourds
sabots
qui
traînent lorsque la terre enfonce ...
Faits
de
bois
dur,
de
frêne,
de
hêtre
ou
d'orme
pour
l'hiver,
de
vergne
pour
l'été,
plus
légers, ou sabots fantaisie en noyer.
Certains,
destinés
aux
marins,
taillés
dans
le
bois
tendre
du
peuplier,
ne
causaient
aucun
dommage aux ponts des bateaux !
Sur
le
dessus
du
pied,
un
coussinet
joliment
roulé
et
une
semelle
intérieure,
tous
deux
confectionnés en paille de seigle, donnaient un certain confort et gardaient le pied au sec.
Le "sabaron", sorte de guêtre en cuir, parfois fixé au sabot, complétait la protection.
Il
était
d'usage,
afin
d'éviter
qu'ils
ne
se
fendent,
d'entourer
le
dessus
des
sabots
avec
un
fil de fer.
Celui-ci
nommé
"pionnette"
ou
"arçon"
était
vendu
sur
les
foires
et
marchés
par
quelques
pauvres bougres qui ont disparu de nos jours.
Jusqu'à
la
dernière
guerre,
avant
que
la
botte
de
caoutchouc
n'envahisse
nos
campagnes, le sabotier faisait partie de la vie quotidienne du Bocage.
Surnommés
"Chausse-Martyrs",
ils
allaient
de
village
en
métairie
où
ils
étaient
attendus
avec impatience ...
Le Saint Patron des sabotiers fut aussi le premier d'entre eux.
En
effet,
Saint
René
(396-450),
évêque
d'Angers,
se
retire
à
Sorento
(royaume
de
Naples), vers l'an 440, pour y façonner des sabots.
Le
jour
de
sa
fête,
le
12
novembre,
les
manœuvres
offraient
leur
journée
de
travail
au
patron sabotier.
Le soir, celui-ci les invitait à un banquet et à des danses.
La fête finissait fort tard dans la nuit voir le lendemain.
Au
XVlllème
siècle
la
production
était
vendue
par
les
boisseliers
(fabricant
de
boîtes
en
bois
et
de
récipient),
les
chandeliers
(fabricant
et
marchand
de
chandelles)
et
les
regrattiers (commerçant de denrée de seconde main) des villes.
Comme
les
charbonniers
(livreur
de
charbon),
les
sabotiers
en
forêt
se
traitaient
de
"bons
cousins" et formaient un corps du Compagnonnage.
Venus
de
la
forêt
où
abondait
la
matière
première,
les
moins
farouches,
lassés
de
leur
vie
d'ermite, se rapprochèrent des villages ouvrirent boutique dans les bourgs.
Aujourd'hui,
il
reste
très
peu
de
ces
artisans
capables
de
dégager
d'une
pièce
de
bois
un
de ces sabots qui protégeait si bien le pied de l'eau et du froid.