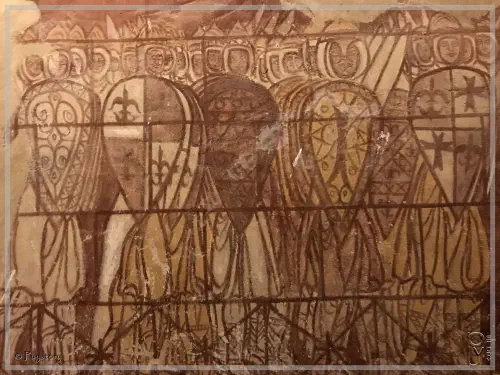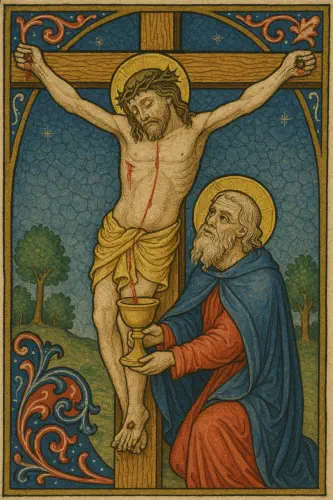Le
nombre
des
chevaliers
de
la
Table
Ronde
varie
selon
les
moments
et
les
récits,
pouvant aller de 12 à 150 voir plus.
Ces chevaliers sont unis par des sentiments de fraternité indissolubles.
Les douze chevaliers principaux de la Table Ronde sont :
SIR GERAINT surnommé : Le Chevalier Secourable
SIR KAY surnommé : Le Chevalier Humble
SIR BEDIVERE surnommé : Le Chevalier Chevaleresque
SIR GAUVIN surnommé: Le Chevalier Charitable
SIR TRISTAN surnommé : Le Chevalier Honorable
SIR GARETH surnommé : Le Chevalier de Confiance
SIR GAHERIS surnommé : Le Chevalier Sincère
SIR LAMORAK surnommé : Le Chevalier Noble
SIR PERCEVAL surnommé : Le Chevalier Courageux
SIR BORS DE GANIS surnommé : Le Chevalier Vertueux
SIR GALAHAD surnommé : Le Chevalier Loyal
SIR LANCELOT du Lac surnommé : Le Meilleur Chevalier du Monde
N'oublions pas la place centrale du Roi Arthur
La
Table
Ronde
se
trouve
à
la
cour
de
Camelot
du
Roi
Arthur,
dont
le
royaume
s'étend
sur
les deux Bretagnes et le Portugal.
Elle est créée suite à la révélation de Merlin l'Enchanteur à Arthur.
La
vision
de
Merlin
est
que
:
Le
Saint
Graal
apparaît
une
fois
aux
chevaliers
de
la
Table
Ronde, recouvert d'un tissu blanc au milieu d'une lumière éblouissante.
Lorsque
les
chevaliers
voient
cette
lumière,
ils
restent
tous
sans
voix
et
une
odeur
épicée
se répand.
Il fallait fonder une assemblée des chevaliers les plus preux afin de retrouver le Graal.
Le Graal est un élément essentiel à l'harmonie entre les hommes.
Il
faut
qu'un
chevalier
de
la
Table
Ronde
le
trouve
et
regarde
ce
qu'il
contient
pour
que
le
monde continue à fonctionner.
Selon
la
légende,
le
Graal
est
le
calice
dans
lequel
le
Christ
aurait
bu
lors
du
dernier
repas avec les apôtres.
Ce calice aurait contenu son sang après la crucifixion.




L'Origine de la Quête du Saint-Graal
La
quête
du
Saint-Graal
représente
l'une
des
plus
fascinantes
légendes
médiévales,
mêlant
spiritualité chrétienne, mythologie celtique et idéaux chevaleresques.
Explorons
ensemble
les
origines
complexes
de
cette
quête
légendaire,
son
évolution
à
travers
les
siècles,
et
comment
elle
est
devenue
un
symbole
universel
de
recherche
spirituelle
et
de
transcendance.
Émergence du Mythe du Graal
Le
mythe
du
Saint-Graal
fait
sa
première
apparition
littéraire
à
la
fin
du
XIIe
siècle
dans
l'œuvre
"Perceval
ou
le
Conte
du
Graal"
de
Chrétien
de
Troyes
(1130-
1190), composée entre 1180 et 1190.
Dans ce texte fondateur, le Graal demeure un objet aux contours imprécis et au rôle mystérieux, bien loin de l'image définitive qu'il acquerra plus tard.
Perceval,
jeune
chevalier
naïf
et
héros
central
du
récit,
assiste
à
une
procession
énigmatique
où
figure
le
Graal,
mais
n'ose
pas
poser
de
questions
sur
sa
nature ou sa fonction.
Ce silence fatidique devient le point de départ d'une quête qui s'étendra bien au-delà du récit original et marquera profondément la littérature médiévale.
Cette première version ne définit pas clairement le Graal comme un calice chrétien.
Chrétien de Troyes décrit plutôt un plat ou un récipient précieux, richement orné et dégageant une lumière surnaturelle.
L'inachèvement
de
son
œuvre
laissera
place
à
de
nombreuses
continuations
et
interprétations
qui
enrichiront
progressivement
la
symbolique
de
cet
objet
mystérieux.
Les Racines Mythologiques
Avant
sa
christianisation,
le
Graal
puiserait
ses
origines
dans
un
riche
terreau
de
mythologies
anciennes.
Les
spécialistes
ont
identifié
de
nombreuses
connexions
avec
des
récits
préchrétiens,
particulièrement celtiques.
Influence Celtique
Le
chaudron
magique
du
Dagda,
divinité
irlandaise,
offrait
une
nourriture
inépuisable
et
possédait
des pouvoirs de résurrection.
Roger
Sherman
Loomis
(1887-1966),
éminent
médiéviste,
a
fermement
défendu
la
thèse
d'une
origine principalement celtique du Graal.
Héritage Indo-européen
On
retrouve
des
similitudes
frappantes
avec
les
vases
et
récipients
d'abondance
présents
dans
diverses
mythologies
indo-européennes,
notamment
la
corne
d'abondance gréco-romaine (cornucopia).
Motif Universel
Le
thème
du
contenant
magique
dispensant
nourriture
et
boisson
sans
jamais
se
vider
apparaît
dans
de
nombreuses
cultures,
suggérant
un
archétype
universel que le Graal viendra incarner dans sa forme médiévale.
La Christianisation du Mythe
La transformation décisive du Graal en relique chrétienne s'opère au début du XIIIe siècle sous la plume de Robert de Boron.
Dans
son
œuvre
"L'Estoire
dou
Graal",
il
établit
formellement
l'identification
du
Graal
au
Saint
Calice
utilisé
par
Jésus-Christ
lors
de
la
Cène,
son
dernier
repas avec les apôtres.
Cette christianisation représente un tournant majeur dans l'évolution du mythe.
Le Graal devient non seulement la coupe utilisée lors de la Cène, mais aussi le récipient ayant recueilli le sang du Christ lors de la crucifixion.
Cette double symbolique eucharistique et sacrificielle confère au Graal une puissance sacrée incomparable.
L'intégration aux récits du cycle arthurien enrichit encore davantage la légende.
Le
Graal,
désormais
objet
de
vénération
chrétienne,
trouve
sa
place
au
cœur
des
aventures
des
chevaliers
de
la
Table
Ronde,
transformant
leurs
quêtes
en
véritables pèlerinages spirituels et établissant un pont entre les traditions chevaleresques et la spiritualité chrétienne médiévale.
Joseph d'Arimathie et la Translation du Graal
Récupération
Joseph d'Arimathie récupère la coupe utilisée lors de la Cène et recueille le sang du Christ crucifié.
Emprisonnement
Emprisonné pour avoir enseveli le corps de Jésus, Joseph est nourri miraculeusement par le Graal pendant 42 ans.
Voyage
Libéré, il entreprend un long périple vers l'ouest, transportant la précieuse relique jusqu'à l'île de Bretagne.
Préservation
Établissement d'une lignée de gardiens du Graal et construction d'un château pour abriter la relique sacrée.
Le récit détaillé de ce transfert apparaît notamment dans l'"Estoire de Saint Graal" vers 1240.
Ce
texte
développe
considérablement
le
rôle
de
Joseph
d'Arimathie,
créant
une
généalogie
sacrée
et
une
mystique
autour du Graal qui sera ensuite reprise dans de nombreuses œuvres médiévales.
La
disparition
mystérieuse
du
Graal
devient
alors
le
moteur
narratif
qui
justifiera
la
quête
entreprise
par
les
chevaliers arthuriens.
La Quête Spirituelle
Vers
1220,
l'œuvre
anonyme
"La
Queste
del
Saint
Graal"
consacre
définitivement
le
caractère
religieux et mystique de la quête.
Probablement
rédigée
dans
un
contexte
monastique,
cette
version
transforme
profondément
la
signification
du
Graal,
qui
devient
un
symbole
manifeste
de
la
Grâce
divine
et
de
la
présence
réelle du Christ.
La
quête
n'est
plus
simplement
une
aventure
chevaleresque
mais
une
véritable
odyssée
spirituelle.
Le
Graal
est
désormais
présenté
comme
conférant
l'immortalité
à
ceux
qui
boivent
dans
la
coupe
sacrée, non pas sous forme d'immortalité physique, mais comme promesse de salut éternel.
Les
chevaliers
qui
entreprennent
cette
quête
ne
sont
plus
de
simples
guerriers
en
quête
de
gloire,
mais des pèlerins spirituels cherchant la rédemption et la transcendance.
"Et
quant
il
vint
au
Graal,
si
s'agenoilla
devant
et
dist
que
beneoit
fust
Nostre
Sires
qui
li
avoit
soffert a venir en si haut servise come de veoir aucune partie de ses secrez."
Ce
passage
de
la
quête
matérielle
à
la
quête
spirituelle
marque
l'apogée
de
la
christianisation
du
mythe
et
transforme
profondément
la
structure
narrative
des récits arthuriens, introduisant une dimension contemplative et mystique jusqu'alors inédite dans la littérature chevaleresque.
La Table Ronde et les Chevaliers
Arthur
:
Le
roi
qui
envoie
ses
chevaliers
à
la
quête
du
Graal,
symbolisant
l'autorité
temporelle
qui
reconnaît la primauté du spirituel.
Galaad : Fils de Lancelot, chevalier parfait et pur, prédestiné à accomplir la quête du Graal.
Perceval
:
Personnage
originel
de
la
quête,
incarne
l'innocence
et
la
pureté
nécessaires
pour
approcher le Graal.
Lancelot
:
Chevalier
valeureux
mais
imparfait,
son
amour
adultère
pour
Guenièvre
l'empêche
d'achever la quête.
Bohort : L'un des rares à accomplir la quête, représente la persévérance et l'humilité.
L'intégration
complète
du
Graal
dans
le
cycle
arthurien
constitue
l'une
des
plus
brillantes
synthèses littéraires du Moyen Âge.
Les
valeurs
chevaleresques
traditionnelles,
courage,
loyauté,
prouesse,
se
trouvent
réinterprétées
à
la
lumière
de
vertus
chrétiennes
comme
la
pureté,
l'humilité et la foi.
Cette fusion a produit un ensemble narratif d'une richesse exceptionnelle qui continue d'inspirer créateurs et penseurs jusqu'à nos jours.
L'Héritage et les Interprétations
À
travers
les
siècles,
le
Graal
n'a
cessé
de
faire
l'objet
d'interprétations
multiples,
dépassant
largement
son
cadre médiéval initial.
Des lectures ésotériques aux adaptations modernes, cet objet légendaire continue de fasciner et d'inspirer.
Les
débats
sur
son
origine
réelle
(orientale,
celtique
ou
purement
chrétienne)
persistent
dans
les
milieux
académiques.
Certains
chercheurs
ont
même
proposé
des
connexions
avec
des
traditions
gnostiques
ou
des
cultes
à
mystères antiques, élargissant encore le champ des interprétations possibles.
L'influence du Graal sur l'art, la littérature et l'imaginaire collectif est considérable.
Des
œuvres
médiévales
aux
romans
modernes,
des
tableaux
préraphaélites
aux
productions
cinématographiques
contemporaines,
la
quête
du
Graal
s'est
transformée
en
métaphore
universelle
de
la
recherche spirituelle et existentielle.
Le
mystère
persistant
entourant
la
nature
et
la
localisation
du
Graal
continue
d'alimenter
fantasmes
et
recherches.
Des
lieux
comme
Glastonbury,
Montségur
ou
même
Rosslyn
Chapel
ont
été
proposés
comme
dernières
demeures de la relique sacrée.
Cette
incertitude
même
contribue
à
la
pérennité
du
mythe,
faisant
de
la
quête
du
Graal
le
caractère
de
toute
recherche inachevée et de tout idéal poursuivi, mais jamais pleinement atteint.