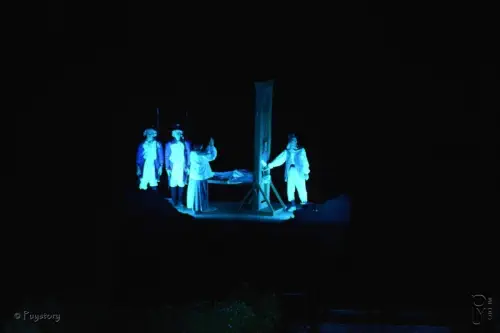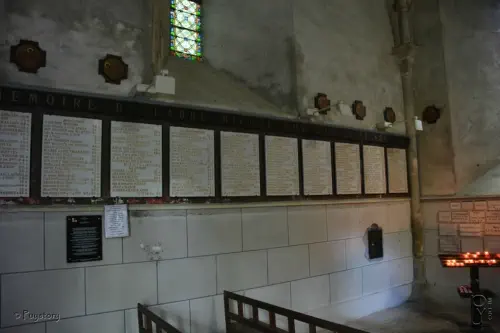D'abord il y eut une guerre.
"Une guerre de géants", a dit Napoléon.
Deux grandes armées face à face :
celle de la République et celle du Roi.
Les
Bleus
qui
s'élançaient
derrière
les
trois
couleurs,
les
Blancs
dont
le
drapeau
était
le
Sacré-Coeur.
"Les rebelles se battaient comme des tigres, a dit Kléber, et nous comme des lions".
S'il y eut des morts, beaucoup de morts, c'est surtout au combat.
S'il y eut des massacres - il y en eut beaucoup - c'est autour et à la suite des combats.
Marceau témoigne, comme s'il s'agissait d'une routine :
"Nos soldats en firent une boucherie épouvantable".
Mais la Grande Armée Catholique et Royale ne faisait pas non plus de cadeaux.
Cette
guerre-là
s'est
achevée
quand
les
derniers
carrés
vendéens
furent
écrasés
à
Savenay, les 22 et 23 décembre 1793, par les troupes de Westermann.
A
l'intention
du
Comité
de
Salut
public,
et
sans
ambiguïté,
ce
général
bleu
avait
dressé
l'acte de décès de la Vendée en armes :
"Il n'y a plus de Vendée, citoyens...
Elle est morte sous notre sabre libre.
Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay...
J'ai
écrasé
les
enfants
sous
les
pieds
des
chevaux,
massacré
les
femmes
qui,
au
moins
pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands.
Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher".
Selon Kléber, la victoire républicaine réduisait les insurgés au désespoir.
De petites bandes de fidèles suivaient encore Stofflet et La Rochejaquelein.
Quelques autres obéissaient à Charette.
Surtout, répétait Kléber, surtout que l'on ne s'avise point de vouloir "ratisser" le pays.
Pour parvenir à la pacification, de simples opérations de police devaient suffire.
Aujourd'hui encore, sa lucidité nous saisit :
"On
forcerait
tous
les
paysans
de
l'intérieur,
qui
ne
demandent
plus
que
la
paix,
à
se
réunir en masse, et l'on verrait une nouvelle armée se former dans la Vendée."
On n'a pas écouté Kléber.
Déjà, à Nantes, le représentant Carrier cherche comment vider les prisons trop pleines.
Les noyades sont pour demain.
Et le général Turreau vient d'être nommé à la tête de l'armée de l'Ouest.
Turreau.
Le voilà donc qui entre en scène.
Quand un spectacle frappe le public, il réclame l'auteur.
L'auteur, ici, c'est Turreau.
Une brute militaire ?
Pas même.
Avant
la
Révolution,
ce
fils
d'un
directeur
des
domaines
du
Roi
s'appelait
Turreau
de
Garambouville.
Il servait aux gardes de Monseigneur le comte d'Artois.
Les idées nouvelles ne semblent l'avoir séduit qu'au printemps de 1791.
Les
volontaires
qui
s'en
allaient
aux
frontières
défendre
la
patrie
en
danger
avaient
élu
lieutenant-colonel cet homme expérimenté.
Le
voilà
aux
armées
du
Nord,
il
passe
général
de
brigade
et,
un
mois
plus
tard,
général
de division.
Il
sera
commandant
en
chef
de
l'armée
des
Pyrénées-Orientales,
d'où
on
l'appellera
dans
l'Ouest.
Pour le malheur de l'Ouest.
Il a trente-sept ans.
Il connaît la région.
Il y revient pénétré d'une certitude :
toute
manifestation
d'humanité
sera
comprise
par
les
insurgés
comme
une
preuve
de
faiblesse.
D'emblée Turreau va écarter le plan de pacification proposé par Kléber :
"Ce n'est pas le mien !".
Il
veut
agir
selon
un
texte
qui,
pour
lui,
se
révèle
une
bible
:
le
décret
pris
le
1er
août
1793
par la Convention nationale.
Exaspérée
parce
que
les
Vendéens
l'emportent
partout,
elle
a
ordonné
que
les
bois,
les
taillis,
les
genêts,
les
forêts
des
rebelles
seraient
détruits,
que
les
récoltes
seraient
coupées,
les
bestiaux
saisis,
les
femmes
et
les
enfants
déportés
dans
l'intérieur
de
la
République.
Ce décret, on n'a eu ni le temps ni la possibilité d'en pousser jusqu'au bout l'application.
C'est la tâche que se donne Turreau.
Même il veut aller plus loin.
Le vendredi 17 janvier 1794, aux 102.709 hommes qu'il lâche sur la Vendée, il ordonne :
-
Tous
les
brigands
qui
seront
trouvés
les
armes
à
la
main,
ou
convaincus
de
les
avoir
prises pour se révolter contre leur patrie, seront passés au fil de la baïonnette.
On en agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas...
Tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes".
C'est
muni
de
cet
ordre
terrifiant
que
douze
colonnes
vont
progresser
dans
un
pays
exsangue.
Il
ne
faudra
pas
longtemps
pour
qu'elles
méritent
le
nom
dont
l'Histoire
les
a
marquées
pour jamais :
les Colonnes infernales.
Turreau a proclamé :
"La Vendée doit être un cimetière national." ?
Elles foncent d'est en ouest, les Colonnes infernales.
Comme Turreau l'a voulu.
Chacun de leurs chefs connaît sa mission : il faut anéantir la Vendée et les Vendéens.
Peu de temps plus tard, Gracchus Babeuf le comprendra le premier en inventant le mot :
On a voulu dépopulationner la Vendée.
La Vendée flambe.
Les Vendéens meurent.
Les responsables rendent compte.
Le général Grignon :
"Cela va bien, nous en tuons plus de cent par jour..."
Le général Cordelier - retenez bien ce nom :
"J'avais
ordonné
de
passer
au
fil
de
la
baïonnette
tous
les
scélérats
qu'on
aurait
pu
rencontrer et de brûler les métairies.
Mes
ordres
ont
été
ponctuellement
exécutés
et,
dans
ce
moment,
quarante
métairies
éclairent la campagne...
J'ai
fait
passer
derrière
la
haie
-
cela
veut
dire
fusiller
-
environ
six
cents
particuliers
des
deux sexes!...".
Le général Duquesnoy : "J'ai brûlé et égorgé tous les habitants que j'ai trouvé."
L'adjudant commandant Névy : "J'ai brûlé et cassé la tête à l'ordinaire."
On tue.
On brûle.
Les rapports s'accumulent au quartier général de Turreau.
Le
général
Avril
:
"J'ai
couché
les
insurgés
de
Saint-Lyphard
par
terre
au
nombre
de
cent...
Il en a été grillé une quantité dans les brûlis de toutes les maisons du faubourg."
Ces insurgés ont-ils tous pris les armes ?
S'agit-il des "brigands" dénoncés par les textes officiels ?
Nullement.
Ce
sont
des
habitants
restés
dans
leurs
villages
et
qui
précisément
n'ont
pas
voulu
accompagner
au-delà
de
la
Loire
ceux
qui
avaient
plus
de
raisons
qu'eux
de
redouter
les
Bleus.
Pas de quartier : ce sont les ordres.
Turreau a hésité quant au sort à réserver aux femmes et aux enfants.
Il a cherché à obtenir un blanc seing du Comité de Salut public :
"S'il
faut
les
passer
tous
au
fil
de
l'épée,
je
ne
puis
exécuter
une
pareille
mesure
sans
un
arrêté qui mette à couvert ma responsabilité."
Le Comité a préféré ne pas répondre.
Les
témoignages
les
plus
accablants
émanent
souvent
des
rangs
de
l'armée
républicaine.
Celui du régisseur général Beaudesson :
"Voulant
connaître
et
m'assurer
par
moi-même
s'il
restait
encore
des
subsistances
à
enlever
des
maisons
éparses
çà
et
là
à
moitié
brûlées,
je
me
transportai
dans
quelques-
unes.
Mais qu'y trouvai-je ?
Des
pères,
des
mères,
des
enfants
de
tout
âge
et
de
tout
sexe,
baignés
dans
leur
sang,
nus
et
dans
des
postures
que
l'âme
la
plus
féroce
ne
pourrait
envisager
sans
frémissement.
L'esprit se trouble même en y pensant."
Nombre
de
ceux
qui
ont
été
les
artisans
de
cette
monstruosité
se
sont
engagés
à
l'appel
de Danton pour défendre la patrie.
Il y a des paysans parmi ceux qui massacrent ces paysans.
Des artisans parmi ceux qui exterminent les artisans.
Des
bourgeois
qui
tuent
d'autres
bourgeois
et
même
des
nobles
pour
commander
l'extermination de ceux qui se battent pour le Roi.
Ils étaient entrés en Belgique ou en Rhénanie.
On leur avait jeté des fleurs.
On
ne
les
traitait
pas
comme
des
conquérants
mais
comme
les
ambassadeurs
de
la
liberté.
Maintenant ils éventraient les femmes et embrochaient les enfants à la mamelle.
Pourquoi ?
Peut-être
un
des
acteurs
de
cette
horreur
sans
nom
va-t-il
hasarder
pour
nous
l'esquisse
d'une impossible réponse.
Il est capitaine.
Il s'appelle Dupuy.
Il appartient
- impossible d'inventer un tel détail - au bataillon de la Liberté !
Il écrit à sa sœur :
"Partout où nous passons, nous portons la flamme et la mort.
L'âge, le sexe, rien n'est respecté.
Hier un de nos détachements brûla un village.
Un volontaire tua ce matin trois femmes.
C'est atroce mais le salut de la République l'exige impérieusement..."
Il a horreur de ce qu'il fait, mais il le fait, parce qu'on lui a dit qu'il fallait le faire.
Et
il
ajoute
:
on
croit
entendre
le
soupir
qu'il
pousse
alors
même
que
sa
plume
trace
les
mots - :
"Quelle guerre !".
Cependant Turreau s'inquiète.
Il
a
instamment
demandé
au
Comité
de
Salut
public
si
son
plan
reflétait
bien
les
intentions de la Convention nationale.
On n'a pas daigné lui répondre.
Il a insisté.
Cette fois avec succès.
On l'imagine décachetant fébrilement le pli scellé aux armes de la République.
Que lit-il ?
Ceci :
"Tu te plains de n'avoir pas reçu du Comité une approbation formelle de tes mesures.
Elles lui paraissent bonnes, et tes intentions pures.
Mais,
éloigné
du
théâtre
des
opérations,
il
attend
les
grands
résultats
pour
se
prononcer
dans une matière où on l'a trompé tant de fois, ainsi que la Convention nationale."
Ainsi on le jugera selon qu'il aura ou non réussi.
Certes, un peu plus loin, on lui conseille d'exterminer de son mieux les brigands.
Mais, en ce temps-là, les généraux républicains qui échouent sont guillotinés.
Turreau en tire cette conclusion qu'il faut redoubler d'énergie.
Ce qui veut dire de férocité. Brûler, brûler, brûler davantage encore.
Et tuer, tuer, tuer.
Un village - plus que tous les autres - va payer le prix de cette implacable résolution.
Son nom ?
Les Lucs-sur-Boulogne.
Que s'est-il passé aux Lucs-sur-Boulogne à la fin de février 1794 ?
Réponse : un épouvantable massacre.
Comment s'est-il déroulé ?
L'historien a le devoir de l'attester : nous l'ignorons.
Nous sommes informés de l'identité des victimes et même de leur âge.
Nul ne saura jamais dans quelles conditions on les a fait mourir.
Si en d'autres lieux, des survivants ont pu témoigner, ici aucun ne l'a fait.
Aucun.
Aux
Lucs-sur-Boulogne,
ce
sont
les
chiffres
qui
parlent
:
plus
de
cinq
cents
personnes,
des
hommes,
des
femmes,
des
enfants
-
surtout
des
femmes
et
des
enfants
-
ont
été
massacrés par les deux colonnes du général Cordelier.
Elles arrivent, ces colonnes.
Elles
approchent
par
ces
chemins
creux
où
l'on
est
vu
sans
jamais
voir
ceux
qui,
tapis
derrière les haies, vous regardent.
Un chef vendéen obsède littéralement les généraux de la République : Charette.
L'ordre a été donné de lui courir sus.
Il est signalé, le 17 février, comme se trouvant aux Petit et Grand-Luc.
Turreau lui-même veut être là pour l'attaque.
Le 22 février, les colonnes se ruent.
Turreau écrit au Comité de Salut public :
"J'ai
vu
enfin
M.
Charette
en
personne,
à
la
tête
de
quelques
tirailleurs,
masqués
par
une
haie".
Il n'a fait que le voir.
Charette s'est dérobé.
Le
28
février
1794,
les
colonnes
du
général
Cordelier
partent
des
landes
de
Bois
Jarry
en
direction des Lucs.
Une colonne traverse la rivière au moulin de l'Audrenière.
Elle
tourne
vers
le
sud
et
se
déploie
pour
remonter
la
rive
gauche
de
la
Boulogne
en
direction du Grand-Luc.
Au
même
moment,
la
colonne
du
commandant
Martincourt
s'avance
sur
la
rive
droite
vers le Chef-du-Pont et le Petit-Luc.
Cordelier,
persuadé
que
"Charette
est
aux
abois"
–
ce
sont
ses
propres
termes
-
fait
savoir,
le
même
jour,
que
ses
colonnes
vont
"exécuter
de
concert
l'attaque
du
Grand
et
Petit Luc".
C'est tout ce que nous disent les rapports officiels.
Et
nous
n'aurions
rien
su
de
ce
qui
s'est
ensuivi,
si
le
curé
Barbedette
n'était
revenu
dans
sa paroisse Saint-Pierre du Grand Luc quelques jours plus tard.
Avec
un
acharnement
qui
nous
bouleverse,
il
a
tenu,
en
s'aidant
du
témoignage
de
quelques
survivants,
à
relever
l'identité
de
ceux
dont
les
cadavres
pourrissaient
à
l'abandon.
Il
faut
que
vous
l'entendiez,
le
curé
Barbedette
énoncer
par
ma
voix
les
dernières
lignes
de la terrible liste qu'il a dressée et qui témoigne devant l'Histoire :
"Lesquels
noms
ci-dessus
des
personnes
massacrées
en
divers
lieux
de
la
paroisse
du
Grand
Luc
m'ont
été
référés
par
les
parents
échappés
au
massacre,
pour
y
être
inscrits
sur
le
présent
registre,
autant
qu'il
a
été
possible
de
les
recueillir
dans
un
temps
de
persécution
la
plus
atroce,
les
corps
ayant
été
plus
d'un
mois
sans
être
inhumés,
dans
les champs de chaque village du Luc.
Ce
que
j'atteste
comme
trop
véritable
après
avoir
été
témoin
oculaire
de
ces
horreurs
et
plusieurs fois exposé à en être aussi la victime
».
Ce 30 mars 1794", signé C. Barbedette, curé de Saint-Pierre-du-Luc.
Point d'autres preuves écrites ?
Si.
Un républicain qui marchait à la suite des légions.
Il s'appelait Chapelain - tenait son journal.
Voici ce qu'il a écrit ce jour-là :
"Journée fatigante, mais fructueuse.
Pas de résistance.
Nous
avons
pu
décalotter
toute
une
nichée
de
calotins
qui
brandissaient
leurs
insignes
du fanatisme.
Nos colonnes ont progressé normalement"
.
Le manuscrit du curé Barbedette dormira quatre-vingts ans dans un grenier.
Quand on le découvrira, certains, de la famille "bleu", crieront à l'imposture.
Ils ne voudront pas croire à tant de barbarie.
Assurément c'est un faux !
En revanche des historiens "blancs" brandiront la liste comme une machine de guerre.
Aujourd'hui - il faut que vous le sachiez, le doute n'est plus permis.
Les archives ont parlé.
Les chercheurs ont prononcé.
Les
ultimes
épreuves
viennent
d'être
apportées
dans
un
travail
définitif
par
Monsieur
Pierre Marambaud.
La liste du curé Barbedette contient 564 noms.
559 ont été confirmés par d'autres sources.
L'effroi
glace
notre
âme
lorsque
nous
découvrons
parmi
eux
les
noms
de
cent
dix
enfants
"de sept ans et au-dessous".
Au village, le cri a retenti : les Bleus arrivent ! Trop tard : ils sont là.
Et
ce
sont
les
portes
que
l'on
enfonce,
les
femmes
qui
hurlent,
celles
qui
crispent
leurs
mains
sur
leur
chapelet
et
s'agenouillent
pour
mourir,
celles
qui
couvrent
leurs
enfants
de
leur corps.
Les hommes impuissants qui serrent les poings ou cherchent en vain une arme.
Et
les
Bleus
qui
déferlent
en
jurant
de
toutes
leurs
forces,
comme
pour
mieux
accomplir
la sale besogne.
Le galop de ceux qui fuient.
Les petits que l'on entraîne.
Les sanglots.
Les cris qui s'achèvent en gémissement d'agonie.
Ceux qui se cachent, ceux que l'on trouve.
Les baïonnettes qui se lèvent, qui frappent, qui fouillent, qui éventrent, qui égorgent.
Les supplications inutiles, les jurons des tueurs qui redoublent.
Ceux que l'on achève.
Ceux qui mettront des heures à mourir.
Et
les
flammes
qui
se
lèvent,
qui
ronflent,
qui
dévorent
tout,
les
maisons,
le
bétail,
les
meubles,
les
bardes
et
aussi
ceux
qui
avaient
cru
sauver
leur
vie
en
se
glissant
dans
quelque soupente.
Le feu, le sang, les larmes.
Il y a deux siècles de cela.
Vous
ne
seriez
pas
morts
pour
rien,
enfants
des
Luc-sur-Boulogne,
si
l'image
et
le
souvenir
de
vos
petits
corps
martyrisés
pouvaient
arrêter
les
bras
qui
se
lèveraient
encore pour commettre de tels crimes.
Rien ne les excuse, rien ne les excusera jamais car ils font régresser le genre humain.
Il faut sans cesse qu'ils soient rappelés à ceux qui nous suivront.
Même
lorsque
les
bourreaux,
aux
yeux
enfin
dessillés,
pleureront
un
jour
sur
leur
barbarie.
Même
lorsque
les
fils
des
victimes,
sans
oublier,
voudront
accorder
leur
pardon
à
leurs
frères égarés.
Extrait du Discours d'Alain Decaux de l'Académie Française, le 25 septembre 1993.