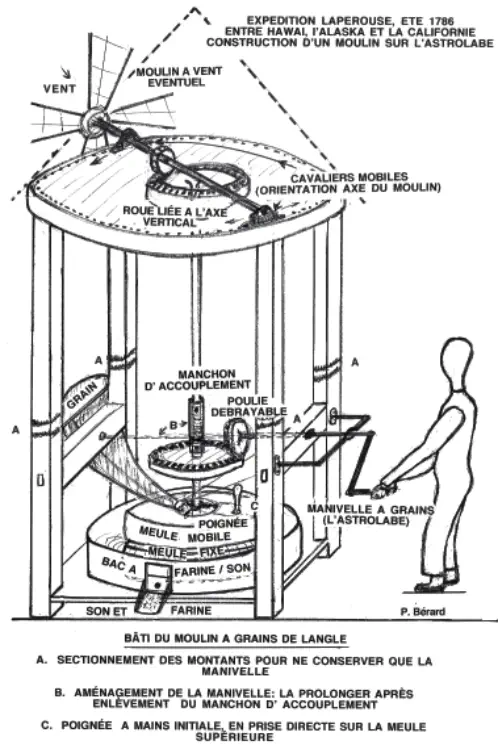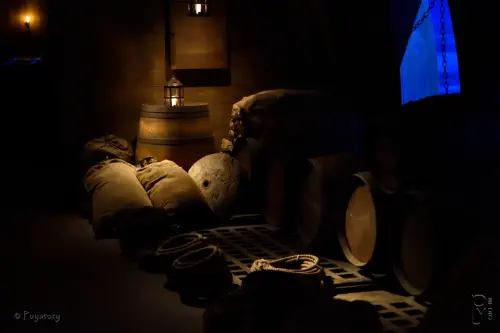Les
moulins
à
farine
sont
une
innovation
de
l'expédition
"La
Pérouse",
connus
au
point
de
devenir un symbole de la silhouette d'au moins un navire.
On
sait
par
ailleurs
que
le
capitaine
de
vaisseau
"de
Langle"
était
très
inventif,
notamment
dans
le
domaine
des
instruments
culinaires
pour
la
santé
des
équipages,
qu'on
devait
préserver dans une aussi longue campagne.
Après
le
départ
des
Îles
Hawaii
(Maui)
vers
l'Alaska,
La
Pérouse
est
préoccupé
pour
la
santé des équipages avec la fraîcheur qui apparaît, route au nord.
Il
encourage
diverses
mesures
de
lutte
contre
l'humidité,
fait
ajouter
secrètement
du
quinquina
au
rhum
du
grog,
et
parle
du
grain,
embarqué
en
France
et
au
Chili,
de
préférence à la farine, pour des raisons de conservation.
Il dit en juin 1786 :
"On nous avait donné des meules de 24 pouces (60 cm) de diamètre sur 4,5 pouces
(11 cm) d'épaisseur.
Quatre hommes devaient les mettre en mouvement.
On
assurait
que
Mr
de
Suffren
n'avait
point
eu
d'autre
moulin
pour
pourvoir
au
besoin
de
son escadre.
Il
n'y
avait
plus
dès
lors
à
douter
que
ces
meules
ne
fussent
suffisantes
pour
un
aussi
petit
équipage
que
le
nôtre,
mais
lorsque
nous
voulûmes
en
faire
usage
le
boulanger
trouva
que
le
grain
n'était
que
brisé
et
point
moulu,
et
le
travail
d'une
journée
entière
de
quatre
hommes
que
l'on
relevait
toutes
les
demi-heures,
n'avait
produit
que
25
livres
(11
kg) de cette mauvaise farine.
Comme
notre
blé
représentait
prés
de
la
moitié
de
nos
moyens
de
subsistance,
nous
eussions
été
dans
le
plus
grand
embarras
sans
l'esprit
d'invention
de
Mr
de
Langle
qui,
aidé
d'un
matelot,
ancien
garçon
meunier,
imagina
d'adapter
à
nos
petites
meules
un
mouvement de moulin à vent.
Il
essaya
d'abord
avec
quelque
succès
des
ailes
que
le
vent
faisait
tourner,
mais
bientôt,
il
leur substitua une manivelle.
Nous
obtînmes
par
ce
nouveau
moyen
une
farine
aussi
parfaite
que
celle
des
moulins
culinaires, et nous pouvions moudre chaque jour deux quintaux de blé".
La
manivelle
et
un
système
de
démultiplication
de
l'effort
(axes,
poulies
ou
engrenages
de
diamètres
différents,
éventuellement
courroies)
étaient
ce
qu'il
y
avait
de
plus
productif
pour une manutention commode de la meule mobile.
Le procédé, quand il a été au point, a évidemment été appliqué aux deux navires.
Le moulin à vent de l'Astrolabe a été laissé à Monterey.
Bien
qu'il
ne
soit
pas
très
agréable
pour
les
officiers
qu'on
vienne
moudre
le
grain
au-
dessus
de
leurs
locaux,
à
l'extrême
arrière,
pour
ne
pas
gêner
la
voile
d'artimon,
de
Lesseps,
un
des
rares
survivants
de
l'expédition
précise
que
De
Langle
a
demandé
d'en
reconstruire un autre après le départ.
Sur
la
Boussole,
navire
de
La
Pérouse,
qui
bénéficiait
d'une
demi-dunette
légère
à
la
poupe,
l'installation
d'un
tel
moulin,
juste
au-dessus
des
locaux
abritant
le
chef
d'expédition, aurait supposé des madriers pour le supporter.
Il n'a donc mis en place que la manivelle.
Le
dispositif
de
Langle
(qui
en
a
peut-être
fait
un
compte
rendu
par
courrier
à
l'Académie
de
Marine,
dont
il
était
membre),
cela
peut
être
aussi
une
concession
aux
équipages
post-révolutionnaires, bien décidés à minimiser les corvées.
On
sait
en
tout
cas
que
ces
moulins
ont
rapidement
disparu
du
paysage
de
la
marine
à
voile, car ils devaient présenter beaucoup d'inconvénients d'encombrement.
Par contre, la "manivelle" a dû être adoptée partout, et éventuellement perfectionnée.